[Tribune] Partenariats Public-Privé : Instrument de croissance ou risque de privatisation ?

Les Partenariats Public-Privé (PPP) sont souvent perçus comme une solution stratégique pour combler le déficit d’infrastructures dans les pays en développement, à l’image du Gabon. Toutefois, leur mise en œuvre soulève des interrogations concernant leur impact réel sur l’économie et le bien-être social. Entre réussites notables et écueils majeurs, ces partenariats peuvent-ils réellement transformer les économies africaines, ou tendent-ils à privatiser des services publics essentiels ? Thierry Biyogo* explore ici ces enjeux cruciaux pour l’avenir du Gabon et de l’Afrique.

Les PPP, bien qu’instruments de développement, risquent de se transformer en un masque pour la privatisation des services publics essentiels si les mécanismes de régulation et de contrôle ne sont pas renforcés. © GabonReview
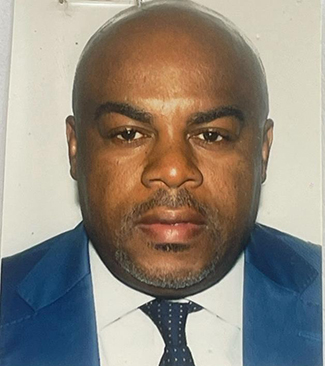
Détenteur d’un MBA de la Strayer University, Washington D.C., Thierry Biyogo est également diplômé de l’ESG Finance de Paris et titulaire d’un Executive Certificate en Finance Internationale et Marchés des Capitaux de la Georgetown University, Washington D.C. © D.R.
Depuis des décennies, les infrastructures publiques ont été la propriété exclusive des États, financées principalement par des fonds publics. Cependant, avec l’émergence des crises économiques, la rareté des ressources financières publiques et le fardeau de la dette publique, les États ont été contraints de repenser leurs modèles de financement et de développement des infrastructures publiques.
C’est ainsi que l’association des secteurs public et privé a émergé, donnant naissance au Partenariat Public-Privé, plus communément désigné sous l’acronyme PPP.
Mais qu’est-ce qu’un PPP exactement ? Quels sont les facteurs essentiels à la réussite d’un tel modèle ? À travers l’exemple du Gabon, quel impact ont ces partenariats sur l’économie gabonaise ? Quels modèles de PPP ont prospéré dans le pays ? Quels défis et limites ont-ils rencontrés ? Les PPP peuvent-ils être considérés comme un modèle de privatisation déguisée des services publics ?
Cet article s’efforcera, à travers des exemples concrets, de mettre en lumière les forces et les faiblesses de ces montages.
Qu’est-ce qu’un Partenariat Public-Privé (PPP) ?
Un partenariat public-privé (PPP) est un contrat écrit, généralement à moyen ou long terme (souvent entre 15 et 25 ans), conclu entre une autorité publique (État, Collectivité locale, Établissement public) et un ou plusieurs opérateurs privés.
Ce contrat confie au partenaire privé une mission globale qui englobe la conception, la construction, le financement, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et la gestion d’infrastructures ou de services publics nécessaires à une mission d’intérêt général.
Le financement est majoritairement assuré par le partenaire privé, qui est rémunéré par des paiements différés de la part de la personne publique ou par les usagers des services, souvent sous forme de loyers basés sur des critères de performance.
Les clés essentielles pour la réussite d’un PPP
Dans son ouvrage publié en 1997, Antonio Vives, responsable de la division des infrastructures et des marchés financiers à la Banque interaméricaine de développement (BID) à Washington D.C., a élaboré un ensemble de principes fondamentaux, appelés « Les Dix Commandements pour la durabilité des infrastructures privées ». Ces principes définissent les conditions clés pour une participation privée durable dans les projets d’infrastructure :
- Obtenir un engagement du gouvernement et un consensus politique majoritaire
- Informer le public sur le processus, ses avantages et ses coûts
- Développer la participation dans un cadre légal, clair, transparent et flexible
- Mener le processus d’attribution des projets avec diligence et choisir le groupe le plus qualifié
- Nommer les meilleurs responsables aux agences de régulation, indépendants et compétents
- Engager le secteur public et privé pour garantir le succès de l’opération
- Ne pas mélanger objectifs sociaux et commerciaux
- Répartir équitablement les coûts et bénéfices
- Fournir au secteur privé les incitations nécessaires, mais uniquement celles indispensables
- Ne pas permettre que les mécanismes d’atténuation des risques compromettent la participation privée.
Ces principes visent à garantir que les infrastructures soient durables, efficaces et équitables, en s’appuyant sur un cadre institutionnel solide et une gestion transparente.
En outre, la durabilité des infrastructures inclut également des aspects comme la résilience, la planification financière à long terme, la conformité aux normes et l’évaluation des risques, afin d’assurer leur fonctionnement optimal et minimiser leur impact environnemental.
En somme, ces principes sont essentiels pour garantir la réussite et la prospérité des PPP.
Quel est l’impact des PPP sur l’économie gabonaise ?
Les partenariats public-privé (PPP) ont connu une évolution significative ces dernières années au Gabon, et ont eu un impact majeur sur l’économie du pays.
Les autorités gabonaises se sont engagées à améliorer les infrastructures pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Les PPP se présentent comme un levier important pour attirer les investissements privés, surtout dans un contexte de contraintes financières et budgétaires. Le cadre juridique qui soutient ces partenariats est régi par la loi n°020/2016, qui établit le cadre institutionnel et légal pour leur fonctionnement. En outre, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI) a mis en place une cellule dédiée aux PPP, renforçant ainsi la viabilité de ces partenariats. Toutefois, les textes régissant l’organe de régulation et de contrôle des PPP sont encore attendus.
Quelques exemples de PPP au Gabon :
- GSEZ (Gabon Special Economic Zone) : Un partenariat entre Olam International, l’État gabonais et Africa Finance Corporation (AFC), qui a permis la création de la zone économique de Nkok et du nouveau port d’Owendo.
- Centrale hydroélectrique et route avec Meridiam : Deux PPP ont été formés avec le fonds d’investissement français Meridiam pour la construction d’une centrale hydroélectrique et d’une route, avec un investissement total de 300 millions d’euros.
- Projet de remise à niveau du Transgabonais et projet Kinguele-Aval : Le gouvernement gabonais bénéficie du soutien de la Société Financière Internationale (SFI) pour la mise en œuvre de ces projets.
Exemples de PPP rencontrant des écueils :
- Le projet de la Transgabonaise : Ce projet routier, qui devait relier Libreville à Franceville, a rencontré d’importantes difficultés. Sur les 780 km prévus, seulement 51 km ont été livrés depuis son lancement en 2020. Les problèmes de financement et de retards ont freiné son avancement, notamment en raison de la faible contribution de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC), et du non-respect des engagements par l’entreprise indienne responsable des travaux.
- Le partenariat entre l’État gabonais et Veolia pour la gestion de la SEEG : L’échec de ce partenariat est dû à plusieurs facteurs, notamment la dégradation de la qualité des services (coupures d’eau et d’électricité fréquentes, factures contestées) et un profond désaccord financier entre l’État et l’entreprise. En 2018, les négociations pour la prorogation du contrat ont échoué, ce qui a conduit à la rupture unilatérale du contrat par l’État.
Malgré ces obstacles, les PPP offrent encore un potentiel important pour l’avenir économique du Gabon. Ils ont amorcé la diversification de l’économie gabonaise et renforcé sa visibilité internationale, notamment grâce aux investissements directs étrangers (IDE), favorisant ainsi la croissance du PIB. De plus, parmi les 320 projets identifiés dans le cadre de la Transition (PNDT), neuf sont inscrits en tant que PPP, représentant un montant global de 874 milliards de FCFA sur un total de 3 692 milliards de FCFA.
Les PPP : privatisation déguisée des services publics ?
Les PPP, par leur structure et leurs objectifs, peuvent être perçus comme une forme de privatisation du service public, puisque l’État confie à un acteur privé une mission globale de service public, y compris la gestion opérationnelle et parfois même le financement des infrastructures. Toutefois, contrairement à une privatisation totale, l’État conserve un rôle central dans l’initiative, la définition du projet et son contrôle. Cette implication publique distingue clairement les PPP d’une privatisation complète.
En conclusion, à l’exemple des écueils rencontrés dans les cas de la SEEG et de la Transgabonaise, il est impératif que l’État mette en place un organe de contrôle et de régulation, comme le prévoit la loi n°020/2016, afin de garantir la bonne gestion des PPP et éviter des situations similaires à l’avenir.


















0 commentaire
Soyez le premier à commenter.