Mangroves : les “arbres-ponts” qui relient mer, terre… et climat

Dans un monde où la frontière entre terre et mer se redessine sous l’effet du changement climatique, les mangroves révèlent leur valeur inestimable. Ces forêts amphibies méconnues stockent jusqu’à cinq fois plus de carbone qu’une forêt tropicale tout en protégeant les littoraux des tempêtes. Pourtant, elles disparaissent à un rythme alarmant. Adrien NKoghe-Mba* invite ici à redécouvrir ces « arbres-ponts » qui relient mer, terre et climat, et à comprendre pourquoi leur préservation constitue un enjeu planétaire.
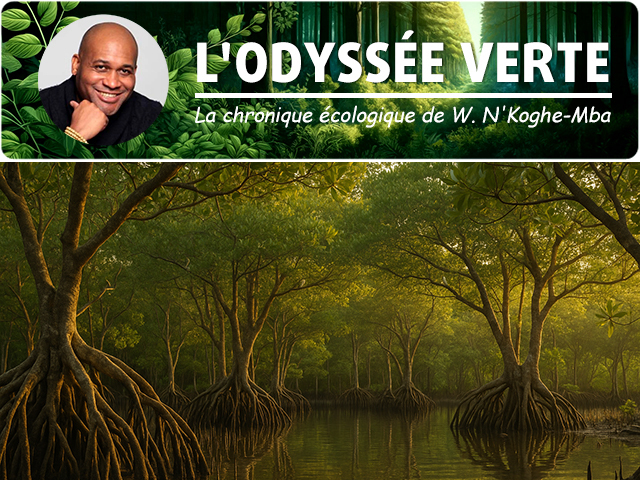
À la frontière incertaine entre l’océan et la terre ferme, là où l’eau salée flirte avec les rivières et les marées dessinent le rythme du vivant, s’étend un monde à part : celui des mangroves. © GabonReview
À la frontière incertaine entre l’océan et la terre ferme, là où l’eau salée flirte avec les rivières et les marées dessinent le rythme du vivant, s’étend un monde à part : celui des mangroves. Ces forêts amphibies, peu connues du grand public, sont pourtant essentielles à l’équilibre de notre planète. Racines noueuses plantées dans la vase, feuillage verdoyant parfois balayé par les vents tropicaux, elles incarnent une passerelle vivante entre écosystèmes, entre espèces, entre enjeux locaux et défis planétaires.
Les mangroves ne sont pas de simples “forêts les pieds dans l’eau”. Ce sont des superpuissances écologiques. À l’échelle du climat, elles jouent un rôle disproportionné. Un hectare de mangrove peut stocker jusqu’à cinq fois plus de carbone qu’une forêt tropicale terrestre. Ce carbone, capturé principalement dans les sols saturés d’eau, y reste piégé pendant des siècles, à l’abri de l’oxygène qui accélère habituellement la décomposition. Ces réservoirs de carbone bleus deviennent ainsi de précieux alliés dans la lutte contre le changement climatique.
Mais leur utilité ne s’arrête pas là. Les mangroves agissent comme des digues naturelles, protégeant les côtes de l’érosion, freinant la houle, et amortissant la violence des tempêtes. Une bande de quelques dizaines de mètres suffit à affaiblir considérablement l’énergie des vagues. Là où elles sont en bonne santé, les dégâts liés aux ouragans sont souvent moindres. On redécouvre même aujourd’hui leur efficacité face à la montée des eaux : elles stabilisent les sols, limitent l’intrusion d’eau salée dans les nappes phréatiques, et préservent les zones agricoles situées en aval.
Sur le plan de la biodiversité, les mangroves sont de véritables maternités marines. Les racines aériennes, véritables labyrinthes immergés, offrent refuge et nourriture à une multitude d’espèces. Poissons, crabes, crevettes, oiseaux, mais aussi jaguars ou lamantins selon les régions, y trouvent un abri indispensable, surtout dans leurs premières années de vie. On estime qu’un tiers des poissons côtiers passent par la mangrove à un moment de leur cycle de vie.
Et pourtant, ces forêts magiques disparaissent. Urbanisation côtière, aquaculture intensive, construction de ports ou de routes, pollution des bassins versants, montée du niveau de la mer : autant de pressions qui font reculer les mangroves à un rythme alarmant. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), près de la moitié des mangroves mondiales sont aujourd’hui menacées d’effondrement.
Mais la tendance peut être inversée. Les initiatives de restauration se multiplient, parfois soutenues par la finance carbone. En plantant des palétuviers, en réhabilitant les hydrosystèmes naturels, en associant les communautés locales aux projets, il est possible de ramener à la vie des milliers d’hectares perdus. Encore faut-il éviter les erreurs du passé : planter les bonnes espèces, aux bons endroits, en tenant compte du rythme des marées et des dynamiques sédimentaires. Les mangroves ne sont pas des monocultures de compensation ; ce sont des écosystèmes complexes, vivants, exigeants.
Si l’on veut que ces arbres-ponts continuent de relier mer, terre et climat, il faudra leur accorder la place qu’ils méritent dans nos politiques, nos budgets et nos imaginaires. Ce n’est pas un luxe tropical, c’est une nécessité climatique. Défendre les mangroves, c’est agir sur tous les fronts à la fois : climat, biodiversité, protection des côtes, souveraineté alimentaire.
Leur sort est peut-être lié à celui de zones humides, aux confins de deltas oubliés. Mais leur importance, elle, est bien universelle.
*Président de l’association Les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo.


















0 commentaire
Soyez le premier à commenter.