Coopération Sud-Sud, forêts tropicales et financement innovant : le Tropical Forest Forever Facility

À l’heure où la planète cherche des solutions concrètes face à l’urgence climatique, une nouvelle mécanique financière se dessine dans le Sud global : le Tropical Forest Forever Facility, un fonds colossal destiné à récompenser la préservation des forêts tropicales. Avec sa plume à la fois lucide et visionnaire, Adrien NKoghe-Mba* décrypte cette initiative appelée à bouleverser l’équilibre du financement climatique et à redonner aux pays forestiers le pouvoir de valoriser leur richesse verte.
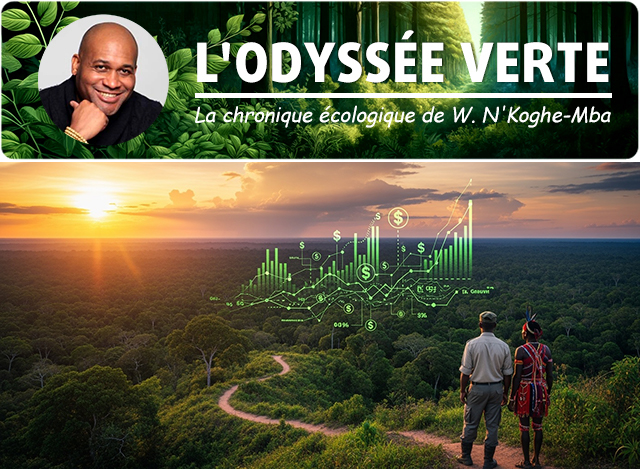
En érigeant un fonds de 125 milliards de dollars, le TFFF fait de la forêt tropicale un capital vivant au cœur du Sud global. La canopée devient une banque naturelle où se croisent biodiversité et capitaux. © GabonReview
Le 12 septembre dernier, la communauté internationale a célébré la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Le thème retenu cette année — « Nouvelles opportunités et innovation à travers la coopération Sud-Sud et triangulaire » — invitait à réfléchir aux manières dont les pays en développement peuvent concevoir ensemble des solutions adaptées à leurs réalités, tout en créant des synergies avec des partenaires extérieurs. L’actualité récente fournit un exemple concret de cette dynamique : le Tropical Forest Forever Facility (TFFF), une initiative en préparation qui illustre la capacité du Sud Global à proposer des instruments financiers innovants pour répondre aux enjeux climatiques.
Les forêts tropicales jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial, la préservation de la biodiversité et le soutien aux communautés humaines. Pourtant, elles demeurent sous-évaluées sur le plan économique. Le TFFF, qui devrait constituer l’un des principaux résultats de la COP30 à Belém, au Brésil, en 2025, propose de combler ce vide en créant un mécanisme financier permanent. L’idée est de mobiliser un capital initial de 25 milliards de dollars en fonds souverains afin d’attirer jusqu’à 100 milliards de dollars d’investissements privés. L’ensemble constituerait un fonds de 125 milliards de dollars, dont les rendements seraient redistribués aux pays tropicaux selon leurs performances vérifiées en matière de conservation.
Il s’agit d’une approche qui associe financement public et capitaux privés dans une logique de long terme. Les ressources générées viendraient compléter les efforts nationaux, sans s’y substituer, et au moins 20 % seraient spécifiquement destinées aux communautés locales et aux peuples autochtones. Pour en bénéficier, les pays participants devront démontrer des résultats tangibles : maintien ou réduction d’un faible taux de déforestation, transparence dans l’utilisation des fonds et mise en place de mécanismes de suivi conformes aux standards définis par la Facility.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la logique de coopération Sud-Sud. En effet, le TFFF est conçu et porté par les pays du Sud Global, qui entendent proposer une réponse collective aux enjeux climatiques. Il s’agit d’un exemple de solidarité entre États confrontés à des défis similaires, mais également d’une manière de rééquilibrer le paysage du financement climatique international, souvent dominé par les pays du Nord.
L’agenda politique du TFFF prévoit plusieurs étapes. La semaine prochaine, le 23 septembre, un événement de haut niveau se tiendra à New York, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Présidé par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, et en présence du Secrétaire général António Guterres, il servira de vitrine internationale pour présenter cette initiative avant son intégration dans les négociations climatiques de Belém. Cette rencontre vise à mobiliser des soutiens politiques et financiers, et à inscrire le TFFF dans le cadre plus large de l’action climatique mondiale.
L’articulation entre le thème de la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud — centré sur l’innovation et les nouvelles opportunités — et le développement du TFFF illustre un mouvement plus vaste. Elle montre comment les pays en développement cherchent à renforcer leurs propres capacités d’action, à mutualiser leurs ressources et à proposer des mécanismes adaptés à leurs réalités. Sans se substituer aux coopérations traditionnelles, cette dynamique vient enrichir le multilatéralisme en offrant de nouvelles perspectives de solutions partagées.
La coopération Sud-Sud apparaît ainsi comme un vecteur de transformation. En mettant en commun leur expérience et leur volonté politique, les pays du Sud entendent faire entendre leur voix sur la scène internationale et apporter une contribution structurante aux grands enjeux planétaires.
*Président de l’association Les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo.



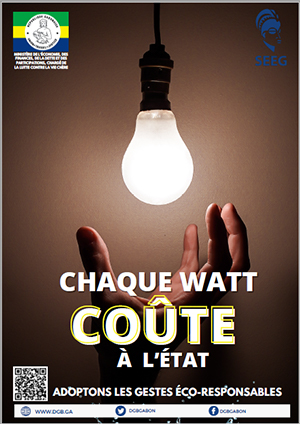














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.