Affaire Nazih : l’activiste qui défiait le pouvoir gabonais arrêté au Liban

La cavale médiatique de Nazih Marwan Al-Azzi, alias X Nazih X, s’est achevée brutalement vendredi dernier à Beyrouth. Interpellé par la Direction générale de la Sûreté générale du Liban, ce jeune Libanais de 25 ans, devenu figure sulfureuse de la scène numérique gabonaise, est désormais au cœur d’un dossier mêlant chantage politique, soupçons de corruption et tensions diplomatiques. Son extradition annoncée vers Libreville pourrait ouvrir l’un des procès les plus explosifs de la Ve République gabonaise.

En prétendant détenir des secrets capables de “faire vaciller le pays”, Nazih a franchi la ligne rouge entre activisme et chantage. Son affaire met au grand jour la zone grise où se mêlent influence numérique, argent public et lutte pour le pouvoir. © D.R.
Personnage à la fois provocateur et énigmatique, Nazih s’est imposé sur TikTok et d’autres réseaux par un mélange d’invectives, de révélations sibyllines et de défi permanent lancé aux institutions gabonaises. Derrière la caricature d’agitateur numérique, se profile un dossier qui interroge la porosité entre pouvoir et influence, et met à nu les dérives d’une nouvelle génération d’«activistes» au Gabon.
Un influenceur devenu affaire d’État
Âgé de seulement 25 ans, Nazih s’est bâti une notoriété fulgurante en surfant sur les codes de la provocation en ligne. Mais ce qui aurait pu rester un théâtre virtuel a viré au scandale national lorsqu’ont émergé des éléments troublants : enregistrements audios, confidences et documents laissant entendre qu’il percevait 4 millions FCFA par mois directement des services de la présidence. Un privilège inouï dans un pays où le SMIG plafonne à 150 000 FCFA.
L’escalade a été rapide. Selon ses propres déclarations publiées en ligne, Nazih Marwan Al-Azzi a accusé la Direction générale de la Sécurité et de la Surveillance (DGSS) de s’être muée en réseau de trafic de drogue opérant à Libreville et Port-Gentil, et d’y maintenir des lieux de détention clandestins (il évoque notamment deux Maliens détenus sans base légale et un proche gardé deux ans). Il a dit détenir 46 enregistrements et 14 vidéos “compromettants” qu’il menaçait de diffuser. De ce fait, il aurait réclamé, selon plusieurs sources concordantes, entre 6 et 10 milliards FCFA au président Brice Clotaire Oligui Nguema, sous menace de divulguer les fameux enregistrements et vidéos compromettantes. Une démarche interprétée comme du chantage
Les cibles de ses attaques publiques allaient donc de la DGSS, pilier du renseignement gabonais, à des personnalités de la magistrature, dont l’avocat Me Jean-Paul Moumbembé et la secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature Paulette Akolly, ou des personnalités politiques comme l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze.
L’ombre du chantage et les répercussions diplomatiques
L’affaire a franchi les frontières lorsque la communauté libanaise du Gabon, inquiète pour sa réputation et ses affaires, a pris publiquement ses distances, qualifiant Nazih de «brebis galeuse». Le 2 août 2025, selon Gabon Télévisions, la Sûreté générale libanaise a mis fin à sa liberté, invoquant la nécessité de protéger les relations stratégiques Gabon-Liban dans des secteurs-clés comme le BTP et l’agro-industrie.
Son extradition vers Libreville, annoncée par Beyrouth, s’inscrit dans le cadre d’une coopération judiciaire rare par sa fermeté. Ce transfert pourrait ouvrir un procès où se joueront plusieurs vérités : l’authenticité des preuves brandies, l’étendue des complicités, et la question centrale de l’utilisation des fonds publics pour rémunérer des figures d’influence.
Le cas Nazih illustre les ambiguïtés d’un phénomène grandissant au Gabon : celui d’«activistes» dont la parole, amplifiée par les réseaux sociaux, oscille entre contre-pouvoir salutaire et outil de règlement de comptes. Dans un paysage politique où l’image se fabrique aussi en ligne, ces influenceurs peuvent devenir, volontairement ou non, des leviers de manipulation, des courroies de transmission de factions rivales ou des instruments de chantage.
L’arrestation de Nazih marque un point d’arrêt brutal, mais pose une question plus large : jusqu’où un État peut-il cohabiter avec des acteurs qui, financés ou tolérés par ses propres réseaux, se muent en menaces contre ses institutions ? Le procès attendu à Libreville dira si cette affaire n’était qu’une manœuvre individuelle ou le symptôme d’une pathologie politique plus profonde.



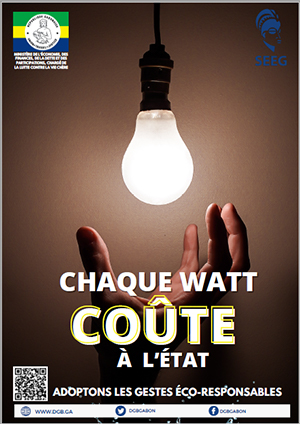














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.