Comptes de campagne : la Cour des comptes joue-t-elle dans la bonne cour ?

En menaçant d’inéligibilité les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes gabonaise a ouvert un débat juridique d’ampleur : cette juridiction est-elle compétente pour contrôler des fonds qui, par nature, relèvent de la vie politique et non des finances publiques ? Au-delà du geste, c’est le fondement même de sa légitimité à intervenir qui vacille.
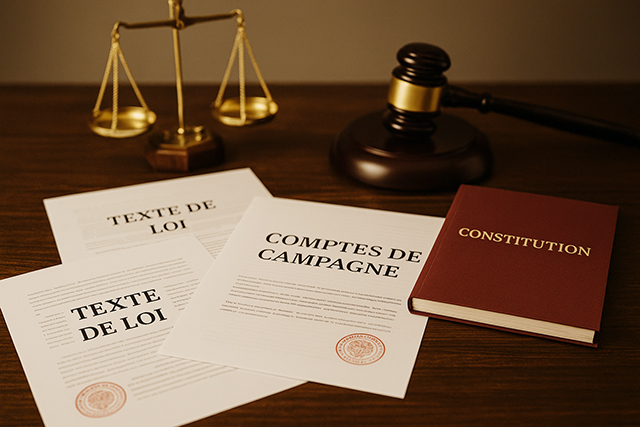
La Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. © GabonReview
C’est une menace qui sonne fort, mais sonne faux. En agitant l’épée de l’inéligibilité (Lire «La Cour des comptes brandit la menace d’inéligibilité») contre les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. Les forums WhatsApp et les réseaux sociaux, souvent théâtre de commentaires approximatifs, ont cette fois levé un lièvre d’une redoutable pertinence : la Cour des comptes est-elle dans son rôle ?
L’incompétence silencieuse de la Cour des comptes
En droit, tout commence avec la Constitution. L’article 133, pierre angulaire de la compétence juridictionnelle, limite explicitement la mission de la Cour à la «vérification des comptes publics» et au «contrôle de la gestion des institutions étatiques et des collectivités publiques». Rien, dans ce texte fondamental, n’évoque son autorité sur les comptes électoraux – qui, faut-il noter, relèvent d’une sphère politique et non institutionnelle. Même la loi organique n°0003/2022 sur les juridictions financières, censée détailler cette mission, reste muette sur tout ce qui touche au champ électoral.
C’est la loi organique n°1/2025, portant Code électoral, qui introduit discrètement une inflexion : en ses articles 109 et 368, elle attribue à la Cour des comptes le soin de recevoir, vérifier et publier les comptes de campagne. Mais peut-on sérieusement prétendre qu’une loi électorale – fut-elle organique – a vocation à modifier ou élargir les compétences constitutionnelles d’une juridiction ? Et peut-elle passer outre une loi spéciale déjà existante sur ladite juridiction ? Là réside la faille, du moins le point de friction sur les réseaux sociaux.
Comparaison internationale : une singularité gabonaise peu tenable
Dans les grandes démocraties, la question du financement électoral est confiée à des organes indépendants et spécialisés. En France par exemple, ce rôle revient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – autorité autonome, distincte de la Cour des comptes. Elle vérifie les comptes, encadre les dons, et transmet ses conclusions aux juridictions compétentes pour sanction. Aux États-Unis, c’est la Federal Election Commission (FEC) qui supervise le financement électoral, enquête, publie et sanctionne en toute transparence. Dans les deux cas, ces institutions disposent de textes précis, de procédures solides et d’une légitimité constitutionnelle claire.
À l’inverse, au Gabon, la Cour des comptes agit sans dispositif juridique complet, sans plafond clairement défini, sans règles sur les dons privés ni encadrement de la preuve comptable. Elle se voit confier une mission hautement sensible sans que sa loi organique n’en trace les contours ni n’en garantisse les garanties procédurales. Cette incongruité, lourde de conséquences, crée une zone de flou où les droits des candidats sont exposés à une appréciation unilatérale et mouvante.
Plus encore : même en admettant cette délégation discutable, la loi électorale ne précise ni la nature des ressources acceptables, ni les plafonds applicables, ni les modalités de preuve. «Que produit-on comme facture lorsqu’on soutient une troupe de danse ou qu’on finance une collation de causerie ?», s’indigne un contributeur. Aucun texte ne répond à ces questions, laissant les candidats dans une insécurité juridique totale.
Ce flou rend la menace de la Cour non seulement discutable, mais injuste. Car comment exiger des comptes clairs quand les règles elles-mêmes sont opaques ? Comment prononcer l’inéligibilité sur la base d’obligations imprécises, voire inexistantes ?
Il serait plus sage de commencer par légiférer. Une loi sur la moralisation de la vie publique, adossée à un texte rigoureux sur le financement électoral, serait un préalable nécessaire. Faute de quoi, la Cour des comptes risque d’être perçue non comme gardienne de la probité, mais comme l’instrument d’une confusion normative aux effets politiques incertains.
















6 Commentaires
Bonjour Mme Annne-Sophie Laborieux,
C’est toujours avec un réel plaisir que je lis vos articles. Celui-ci est intellectuellement stimulant bien que je ne partage pas les arguties.
Le juridisme ne règle pas la question de la transparence et de la confiance en la vie politique de notre pays. La modernisation de la vie politique a suivi des étapes précises notamment par l’adoption de la nouvelle constitution et du code électoral. Il y a peut-être un angle mort ou zone grise: le contrôle des comptes de campagne et la compétence de la Cour des comptes en la matière.
Si Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a bien déposé ses comptes de campagne auprès de la Cour des comptes, c’est parce qu’il est la seule institution à vérifier les comptes publics dans notre pays. Dès lors qu’on participe à une élection publique, il est impératif de fournir des comptes de campagne et d’etablir l’inventaire de son patrimoine privé. Tout enrichissement illicite est par ailleurs est une crime financier.
Je ne pense pas que les comptes de campagne de Monsieur ACBBN pose problème. A titre d’idée, le Ministre de l’Intérieur peut demander la création d’une commission non permanente du contrôle des comptes de campagne de tous les différents.es candidats.es à l’élection présidentielle. En cas de réserve des comptes ou d’impossibilité de les contrôler, alors cette commission transmettra la dossier à la Cour constitutionnelle qui prendra les mesures adaptées pouvant aller jusqu’à l’inégibilité.
Cette commission peut être composée ainsi :
-2 député.es ;
– 2 sénateurs ;
– 2 membres de la société civile (1 expert-comptable et 1 commissaire aux comptes);
– 2 militaires officiers supérieurs;
– 1 magistrat.
Notre pays ne se réduit pas à un seul individu : Monsieur Alain-Claude Billie-by-Nzé. La volonté de modernisation de notre société aura un impact sur l’ensemble des gabonais.es. L’essor vers la félicité a un sens que si nous produisons des efforts dans le changement de mentalités afin d’en récolter les fruits demain. Ce qui me conduit à théoriser ma pensée : les racines du changement sont amères; mais doux en seront les fruits.
Bien à vous.
Les commissions et autres agences déployées pour accompagner ou corriger les faiblesses des institutions, ont fait le lit des coquins et copains de la prédation et des délinquants financiers, au détriment du pays
Le Gabon vient de se doter pour la toute première fois depuis son indépendance en 1960, d’une constitution pensée et écrite par son peuple pour son épanouissement, la prospérité véritable et le développement du pays
Cette constitution sera bien évidemment enrichie graduellement tout autant que les institutions qui accompagnent sa mise en œuvre, tel qu’il est observé dans les vieilles démocraties qui nous inspirent
Mettons un terme au réflexe de création de commission à tout va, s’agissant du problème posé par Bille Alain, l’institution Cour des Comptes est fondée sous sa forme actuelle à tracer l’origine et la nature des fonds privés ou publics de tout candidat appelé à se présenter à une élection pour assumer des responsabilités publiques au service du peuple souverain . Cette mission de vérification est étendue à l’éthique ou moralité de tout donateur privé, toute chose à laquelle veulent s’extraire les disciples du juridisme, et c’est leur affaire.
Stop au juridisme de petite vertu et de la bêtise au service de la délinquance qui aura conduit une clique d’individus porteurs d’anti valeurs à :
1) détricoter la constitution au détriment du peuple souverain en l’assujettissant à la satisfaction de leurs propres fantasmes adossés à ceux de l’individu président usurpateur
2) aliéner les statuts du pseudo parti dit de masse superbement illustré sans foi ni loi en entraînant dans les abîme tout une nation deux générations durant
l’institution président de la République est au service du peuple, seul souverain. Aussi, tout postulant aspirant à assumer cette fonction pour servir le peuple se doit de montrer patte blanche, s’agissant particulièrement du financement de la campagne ouvrant l’accès à la magistrature suprême
Non messieurs les fans du juridisme de la bêtise, la souveraineté du peuple ne saurait être affectée dans son intégrité parce que :
à) gabonais né de père et de mère que je suis, et versé toutefois dans l’exploitation illégale d’or, pour avoir financé à titre privé la campagne de Bille Alain, président par accident devenu, je puis le permettre de lui imposer de blanchir mes activités de prédateur accompli,
b) un baron de la drogue tapis au fin fond de la Colombie puisse s’autoriser de venir exiger à Bille Alain d’autoriser ses aéronefs transportant des stupéfiants de transiter à Libreville vers les destinations de consommation, en contrepartie des contributions apportées à titre privée à sa campagne
Il n’est nullement besoin ds marbrer de façon spécifique ses volets de contrôle du gendarme comptable qu’est la Cour des Comptes, au service du peuple gabonais ayant le devoir de prévenir tout ce qui serait de nature à affecter directement et/ou indirectement l’intégrité de sa souveraineté.
Ce volet contrôle est tout naturellement étendu à la fiabilisation des NIP, et leurs modalités de mise à disposition de cette information cardinale dans le cadre du traitement des listes des 12k adhérents exigés aux partis politiques, la Cour ne saurait prendre en compte, pour qu’elle que raison qu’il soit, un NIP libéré par procuration.
À la Cour des Comptes, vous avez du boulot et bonne continuation, à Bille Alain et acolytes versés dans le juridisme de la délinquance, un peu de respect pour le peuple souverain, même si, tout autant que tu l’as déclaré, et tu as été bien servi par la suite, la transition ne serait pas une disposition constitutionnelle, et tu en diras sans doute autant pour « le respect du peuple souverain »….effectivement, s’agissant de ces réparties, Camus disait… »la bêtise insiste toujours »…
Mettons donc un terme au juridisme de la bêtise
Bassé, mon frère !
Ce que vous dites est tout à fait pertinent. Beaucoup de pays africains doivent leur instabilité aux alliances douteuses que certains chefs politiques entretiennent avec des « mains noires », auxquelles ils se sentent plus redevables qu’envers leur propre peuple.
Même si Bilie Bi Nze n’a rien reçu directement de l’État, les Gabonais ont besoin d’être rassurés qu’il n’est pas soumis à l’influence d’intérêts mafieux ou contraires aux intérêts de la nation, via le financement de ses activités politiques.
Protester contre l’utilisation des moyens de l’État par le candidat Oligui, sans que les autres candidats ne bénéficient d’un financement public, est une chose. Mais être transparent sur l’origine des fonds de sa propre campagne dans un environnement aussi fragile en est une autre , et cela est crucial pour la stabilité du pays.
Que Bilie Bi Nze ne se laisse pas emporter par ses émotions ni par sa colère liée à l’interruption prématurée de son mandat de Premier ministre. Qu’il présente ses comptes de campagne. À moins qu’il n’ait quelque chose à cacher ?
Anne-Sophie, nous savons bien votre sympathie pour Alain-Claude Bilie Bi Nze. Mais la loi, même imparfaite, ne peut ni être défiée ni violée impunément. Si Bilie Bi Nze refuse de soumettre ses comptes de campagne, il est nécessaire, pour préserver l’ordre et le respect des institutions, qu’il en assume pleinement les conséquences.
On ne peut pas laisser ouverte une boîte de Pandore qui aboutirait à une défiance permanente envers nos institutions, surtout de la part de ceux qui aspirent à les diriger. Pas grand monde ne va pleurer si monsieur 3% devient inéligible.
Sous Ali Bongo et son entourage, les lois étaient manipulées entre « copains et coquins », choisies et imposées au peuple selon leurs intérêts. Cette fois-ci, cette Constitution et ce président, malgré leurs imperfections, ont été choisis par les Gabonais à une écrasante majorité.
Bilie Bi Nze ne peut pas continuer à mépriser les aspirations et les choix d’un peuple tout entier simplement parce qu’il se croit au-dessus de tout ou plus intelligent que les autres Gabonais.
On demande de respecter la règle de droit, mais quand celle-ci présente des incohérences au regard d’autres règles de droit (en l’espèce ici de rang supérieur) et qu’on le dénonce, on demande de cesser ce juridisme. Voilà qui est très étrange. Il faut vraiment que la règle de droit soit appliquée (de façon bête et servile surtout) , sans qu’on ne puisse essayer d’en analyser la pertinence et la validité juridique. Derechef : voilà qui est étrange.
On est confronté à un problème juridique qui va fort probablement se régler devant un juge. ACBBN, va probablement être déclaré inéligible s’il ne change pas sa position. J’espère quand même, comme cela doit être en toute circonstance, que la procédure sera contradictoire pour lui permettre de faire entendre ses exceptions. Celle mentionnée à l’article 120 de la constitution me parait inenvisageable en l’espece, puisqu’elle ne concerne que la défense des droits fondamentaux. Or, ACBBN évoque un vice d’incompétence au regard des dispositions de la constitution. Et si l’atimie était retenue malgré tout, cela serait intéressant de savoir comment dans un système constitutionnaliste une loi peut méconnaître la constitution et s’il faut se dire qu’en réalité la doctrine du Gabon est celle d’un constitutionnalisme atténué (après qu’on a créé le présidentialisme renforcé).
S’agissant des déclarations de certains ici selon lesquelles le juridisme ne règlera pas le problème de la transparence et de la confiance en la vie politique, permettez-moi d’en rire et d’emetrre ma petite objection. Disposer de règles claires sur le financement de la vie politique est essentiel pour éviter d’avoir des décideurs à la solde d’intérêts privés et pour assainir la vie politique. Et cela un pays comme la France l’a compris. Certes toutes les mauvaises pratiques n’y ont pas disparu (l’actualité est là pour nous le rappeler), mais en termes de transparence, le pays est meilleur que beaucoup d’autres (sans les nommer). La France a forgé sa législation en matière de financement de la vie politique au gré des scandales politico-financiers. L’élément déclencheur est très certainement l’affaire URBA dans les années 80, un scandale politico-financier sur l’attribution frauduleuse de marchés publics et dans lequel était empêtré le Parti socialiste. Le Gabon, comme la France l’a fait, a besoin des règles claires, précises et sans équivoques sur les ressources des partis politiques et candidats aux charges publiques. Et il lui faut en sus des corps assez puissants et honnêtes pour faire respecter, au nom de l’intérêt général, ce que disent les règles.
L’analyse faite par Anne-Sophie Laborieux est d’une pertinence remarquable. Je sais que la tendance que veulent imposer certains ici est que tout le monde dise amen sans poser de question avant de manger la communion que tendent les autorités, mais en tant qu’homo sapiens on ne peut (et ne doit) nier sa nature qui est de réfléchir (en l’espèce en droit, vu que c’est un problème de droit qui est posé).
Cordialement