Coopératives et monde rural : réalités croisées, regards partagés

Deux journées internationales ayant récemment convergé pour célébrer les coopératives et le développement rural, il convient de s’attarder sur les liens profonds entre ces deux réalités souvent marginalisées, non médiatisées, mais essentielles. Dans les zones reculées, là où les infrastructures se font rares mais la solidarité persiste, les coopératives rurales offrent un modèle d’organisation et de résilience. Elles incarnent, par leurs actions discrètes mais structurantes, une réponse concrète aux défis territoriaux et environnementaux du XXIè siècle. Adrien NKoghe-Mba* explore ces croisements avec finesse, en relevant des dynamiques locales parfois négligées, mais cruciales pour un développement équitable et durable.
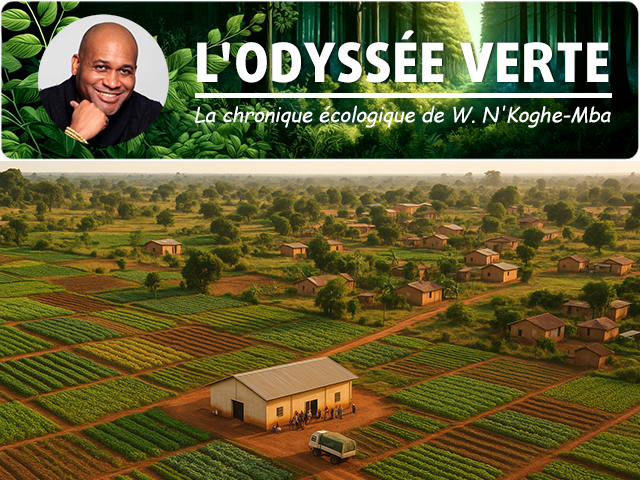
Les grandes transitions – écologique, économique, sociale – s’ancrent aussi dans des lieux concrets, auprès d’acteurs parfois éloignés des projecteurs, mais directement concernés. © GabonReview
Dimanche dernier, deux journées internationales ont été célébrées dans le calendrier onusien et associatif : la Journée internationale des coopératives et la Journée mondiale du développement rural. L’une met en lumière un modèle économique fondé sur la gestion collective et la solidarité ; l’autre attire l’attention sur les territoires qui, dans de nombreux pays, concentrent à la fois les ressources naturelles, les activités agricoles et une grande partie des défis sociaux contemporains.
Ces deux dimensions se croisent sur le terrain, dans des zones souvent éloignées des centres urbains, là où l’accès aux services de base reste irrégulier, où les moyens de production sont modestes, et où l’environnement naturel façonne fortement les modes de vie. Le monde rural n’est pas uniforme. Il peut prendre la forme d’un village forestier entouré de biodiversité, d’un bassin agricole structuré, ou d’une zone de pêche artisanale. Ce qu’il partage souvent, c’est une forte dépendance aux équilibres écologiques et une organisation sociale ancrée dans la proximité.
Dans ce contexte, les coopératives rurales apparaissent comme des cadres de collaboration qui permettent à des producteurs, des éleveurs, des cueilleurs ou des artisans de mettre en commun leurs efforts. Elles facilitent l’accès au crédit, la transformation des produits, la commercialisation, mais aussi la transmission de savoir-faire. En cela, elles contribuent à structurer des filières locales et à maintenir une activité économique dans des zones parfois confrontées à l’isolement ou à l’exode.
Ces formes d’organisation collective, souvent discrètes, s’inscrivent dans les logiques promues par l’Agenda 2030 des Nations unies. Plusieurs objectifs de développement durable sont concernés : l’amélioration des conditions de vie rurales, la réduction des inégalités territoriales, la promotion d’un travail décent, la gestion durable des ressources naturelles. Dans les faits, cela se traduit par des démarches concrètes : mutualiser du matériel agricole, négocier en groupe l’accès à un marché, ou gérer collectivement une ressource forestière.
Les coopératives ne résolvent pas à elles seules les enjeux du développement rural. Mais elles donnent un cadre à l’action collective et à la prise d’initiative locale. Dans des environnements où les équilibres économiques, sociaux et environnementaux sont étroitement liés, ce type d’organisation peut offrir un point d’appui pour stabiliser les activités, renforcer les solidarités et rendre plus visible le rôle des communautés dans la gestion de leur territoire.
Ces journées internationales rappellent ainsi que les grandes transitions – écologique, économique, sociale – s’ancrent aussi dans des lieux concrets, auprès d’acteurs parfois éloignés des projecteurs, mais directement concernés.
*Président de l’association Les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo.


















0 commentaire
Soyez le premier à commenter.