Du fantôme au renouveau : chute d’Andjoua Bongo et espoir à la DGCCRF

La révolte des agents de la DGCCRF a fini par emporter Fabrice Andjoua Bongo Ondimba. Sa révocation, officialisée lors du Conseil des ministres du 8 septembre, marque la fin d’un mandat miné par l’absentéisme et le mécontentement social. Sans mentionner son nom, le communiqué final a acté sa mise à l’écart en nommant Mme Élise Emmanuelle Ntsame Obame nouvelle directrice générale. Une décision lourde de symboles, qui signe la volonté du pouvoir de rompre avec des pratiques de gouvernance héritées du passé.

L’éviction d’Andjoua Bongo de la DGCCRF marque-t-elle la fin d’un mode de gouvernance basé sur les privilèges dynastiques ? © D.R.
La sentence est tombée. À l’issue du Conseil des ministres du 8 septembre, le gouvernement a annoncé la révocation de Fabrice Andjoua Bongo Ondimba de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Un épilogue attendu après des semaines de grève et de contestation qui avaient transformé cette administration en champ de rébellion sociale.
Si son nom n’apparaît pas dans le communiqué final, le remplacement est sans équivoque : un nouveau directeur général a été nommé, en la personne de Mme Élise Emmanuelle Ntsame Obame, désormais appelée à rétablir l’autorité et la crédibilité de l’institution.
Derrière cette décision se joue plus qu’un simple remplacement administratif : c’est tout un symbole qui s’effondre. Nommé en septembre 2023, dans le sillage du coup d’État du 30 août, le fils d’Omar Bongo et demi-frère d’Ali Bongo traînait depuis deux ans une réputation de «directeur fantôme», dirigeant supposément depuis Dubaï une institution stratégique laissée à la dérive. Le surnom qui l’a poursuivi, «fils gâté et absent», est devenu l’étendard de la révolte des agents.
La grève illimitée déclenchée par le syndicat SAACCRF a mis au grand jour les fractures : stagnation des carrières, suspension des primes, décote salariale de 30 %, retards de titularisation. En toile de fond, l’accusation d’un mépris institutionnalisé, accentuée par l’absence chronique d’un dirigeant perçu comme parachuté par ses liens familiaux plus que par ses compétences.
En tranchant, l’exécutif a choisi d’envoyer un signal. Celui d’une rupture avec un mode de gouvernance marqué par les privilèges dynastiques et les nominations de convenance. Certes, le départ d’Andjoua Bongo ne règle pas en un jour les problèmes structurels de la DGCCRF, mais il marque une inflexion politique : la volonté de répondre à la pression sociale et de restaurer une certaine crédibilité dans la régulation économique et la protection des consommateurs.
Ainsi s’achève la trajectoire d’un «directeur invisible» n’en faisant qu’à sa tête, victime d’une contestation devenue irréversible. Mais au-delà d’un homme, c’est une pratique du pouvoir qui est ici remise en cause. L’histoire retiendra que la DGCCRF, en se rebellant, a forcé l’État à solder un héritage encombrant.



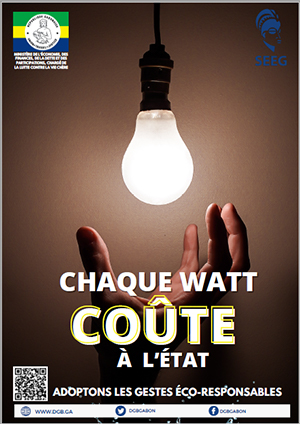














2 Commentaires
Cette famille n’a jamais eu d’attachement réel à notre pays. L’un de ses membres dirige une grande direction, mais vit confortablement à Dubaï. Pour eux, le Gabon n’est rien d’autre qu’une mine lointaine : on accepte de s’y salir pour récolter la richesse, puis on part jouir du luxe et de la « civilisation » ailleurs.
À l’inverse, notre président a toujours préféré passer ses vacances au Gabon, sur nos propres sites, afin de maintenir les capitaux dans l’économie nationale. Comment aurait-il pu se satisfaire d’un directeur général sans aucune fibre patriotique, qui dépense à l’étranger des millions, voire des milliards, acquis grâce au service public ?
Dans la plupart des pays arabo-musulmans, faire sortir des capitaux est extrêmement difficile ; même rapatrier légalement son propre argent relève du parcours du combattant. Au Maroc par exemple, la loi interdit aux citoyens résidents de posséder des comptes bancaires à l’étranger, même si le roi lui-même est accusé d’en violer les règles.
Chez nous, au contraire, des responsables s’enrichissent grâce à l’argent public, deviennent milliardaires, puis transfèrent toutes leurs fortunes hors du pays, au lieu d’investir dans l’économie nationale. La prochaine étape doit être claire : ceux qui s’enrichissent sur le sol gabonais, et surtout grâce au contribuable, ne doivent pas être autorisés à placer l’essentiel de leurs biens et capitaux à l’étranger.
Oligui, cela te concerne directement. Le président Gbagbo a gouverné dix ans sans jamais posséder ni comptes ni maisons à l’étranger. Pourquoi faudrait-il considérer comme « normal » que toutes les élites gabonaises, enrichies par l’État, détiennent des villas à Paris ? Voilà pourquoi notre pays reste en retard malgré ses immenses richesses.
Le Gabon a suffisamment de ressources pour construire non seulement son propre avenir, mais aussi pour inspirer et soutenir l’Afrique. Pourtant, aujourd’hui, notre richesse sert à bâtir l’Afrique du Sud, le Liban, le Maroc, le Sénégal, la France, les États-Unis ou le Canada.
Si tu veux vraiment mobiliser les 7 000 milliards nécessaires pour développer le Gabon, il suffit d’une règle simple : toute personne qui prétend servir l’État ne doit pas avoir plus de 10 à 20 % de son patrimoine détenu à l’étranger.
Si incompétents et tricheurs qu’Andjoua a fait en sorte que ses candidats soient recalés pour être d’office députés à Franceville en 2023. Ce que faisait Malika, c’était sa nièce, et Ali, son frère. Toujours candidats uniques à Bongoville.