Egis se retire du Cameroun : un signal d’alarme pour le Gabon

Le retrait d’Egis du Cameroun, après l’échec retentissant du projet de péages routiers automatiques, dépasse la simple réorganisation d’un groupe français d’ingénierie. Il suscite une question cruciale : comment le Gabon, où Egis pilote encore des chantiers majeurs tel que le projet aéroportuaire de Nkoltang, peut-il éviter un scénario similaire ?

L’aventure camerounaise d’Egis souligne l’urgence pour le Gabon de verrouiller ses contrats d’infrastructures stratégiques. © D.R.
Au-delà d’un fait divers économique, cette décision révèle une fragilité plus large : celle des grands partenariats public-privé quand ils reposent sur des prévisions de trafic optimistes et des garanties bancaires insuffisantes. Pour le Gabon, l’enjeu n’est pas seulement de surveiller un prestataire, mais de repenser la manière de sécuriser ses infrastructures stratégiques.
Un fiasco révélateur
En février 2024, le gouvernement camerounais a brutalement suspendu un partenariat public-privé de 42 milliards FCFA pour la construction de quatorze péages automatiques.
Résultat : arrêt des paiements prévus, licenciement de deux cents salariés et une dette bancaire estimée à une vingtaine de milliards FCFA. Cette rupture est la démonstration de failles profondes : montage financier fragile, partage des risques mal défini et contrôle insuffisant de l’État sur l’exécution du projet.
Ce revers a conduit Egis à envisager la vente de plusieurs de ses filiales africaines pour se recentrer sur l’Europe et le Moyen-Orient. L’image d’un groupe fiable et solide s’en trouve ébranlée, et ce choc résonne bien au-delà du Cameroun.
Partenaire clé au Gabon mais vigilance
Au Gabon, Egis demeure un acteur de premier plan. Le groupe est chargé de la conception et de la gestion du nouvel aéroport international de Libreville à Nkoltang, un chantier stratégique mené aux côtés de GSEZ Airports. Il a également longtemps participé à l’exploitation de l’aéroport Léon Mba. Mais la débâcle camerounaise risque de fragiliser sa réputation et de semer le doute sur sa capacité à garantir la continuité de ses engagements. S’y ajoutent des antécédents de soupçons de corruption dans la sous-région, même si certaines procédures ont été classées.
Pour Libreville, la leçon doit être claire : renforcer les garde-fous contractuels et financiers. Avant de confier une infrastructure stratégique à un partenaire étranger, il devient indispensable d’imposer des garanties bancaires solides, de prévoir des pénalités automatiques en cas de retard et de sécuriser les fonds destinés à l’entretien. Un contrôle indépendant et régulier de l’avancement des projets doit aussi devenir la norme.
Le projet de Nkoltang n’est pas menacé à court terme, mais l’expérience camerounaise rappelle qu’aucun contrat n’est à l’abri d’un revirement. En tirant les enseignements de ce revers, le Gabon peut transformer ce signal d’alarme en opportunité : moderniser ses procédures de passation de marchés, exiger une transparence totale et protéger l’intérêt public. Cette vigilance, loin de décourager les investisseurs, renforcerait au contraire la crédibilité du pays et la fiabilité de ses grands travaux.



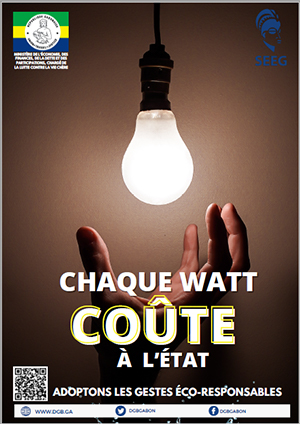














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.