Financement climatique : le Gabon et la Francophonie en quête d’équité verte

Le Gabon, pionnier africain de la conservation et acteur engagé de la transition écologique, accueille une mission conjointe de l’IFDD et de l’OCDE pour dresser un état des lieux du financement climatique. Ce travail s’inscrit dans une dynamique plus large menée dans six pays francophones afin d’identifier les obstacles qui freinent l’accès aux ressources vertes indispensables à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux.

Le 7 mai dernier à Libreville, le ministre de l’Environnement, Mays Mouissi, recevait une délégation conjointe de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) et de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). © D.R.
Le 7 mai dernier à Libreville, le ministre de l’Environnement, Mays Mouissi, recevait une délégation conjointe de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) et de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Cette mission s’inscrit dans un projet comparatif visant à comprendre les freins spécifiques rencontrés. En toile de fond : une étude comparée menée dans plusieurs pays francophones, dont le Gabon, visant à faire l’état des lieux des obstacles à l’accès aux financements climatiques.
La délégation, conduite par Tounao Kiri pour l’IFDD et Eva Beuselinck pour l’OCDE, entend mener des consultations auprès d’un large éventail d’acteurs publics et privés gabonais. Objectif : identifier les barrières institutionnelles, techniques, administratives et même linguistiques qui limitent l’accès de ces pays aux fonds verts internationaux, notamment dans les grandes arènes comme les COP et les instances de financement multilatéral.

. © D.R.
Le Gabon, un leader environnemental, oublié des guichets verts
Le Gabon est souvent présenté comme un élève modèle en matière de préservation de la biodiversité. Avec plus de 80 % de couverture forestière, des politiques actives de lutte contre la déforestation et une économie à faible empreinte carbone, le pays a su faire de son capital naturel un atout diplomatique. Pourtant, l’accès aux financements climatiques reste timide.
« Nous faisons partie des bons élèves, mais nous ne sommes pas récompensés à la hauteur de nos efforts », a fait savoir Mays Mouissi lors de cette rencontre. Il plaide pour une meilleure reconnaissance des politiques écologiques déjà en place, et pour un renforcement des mécanismes d’accompagnement financier destinés aux pays francophones, souvent marginalisés dans les forums internationaux.
Des barrières linguistiques et techniques à lever
Le rapport attendu de cette mission s’inscrit dans une démarche plus large portée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s’agit non seulement d’identifier les freins institutionnels et administratifs, mais aussi de pointer une autre réalité souvent tue : la barrière linguistique. De nombreux appels à projets, dispositifs ou guichets financiers sont pensés en anglais, rendant leur compréhension et leur appropriation difficile dans des contextes francophones.
Face à cette situation, l’IFDD a lancé un Pôle francophone sur l’accès à la finance durable. Cette structure propose des solutions concrètes : formation des cadres étatiques à la structuration de projets bancables, renforcement des cadres réglementaires, harmonisation régionale et plaidoyer pour des financements innovants.
Une mission d’intérêt stratégique pour l’avenir écologique du Gabon
L’étude en cours, qui couvre également le Sénégal, le Togo, Sainte-Lucie et l’Arménie, allie enquête de terrain et analyse documentaire. Elle devra aboutir à des recommandations ciblées, capables de transformer les constats récurrents en politiques publiques efficaces. Pour le Gabon, il s’agit aussi de mieux se positionner dans la rude compétition internationale pour les financements climat, évalués aujourd’hui à 632 milliards de dollars par an, loin des besoins estimés à 5 000 milliards.
Dans ce paysage inégal, les pays francophones peinent à faire entendre leur voix. D’où l’urgence, pour Libreville et ses partenaires, de bâtir un plaidoyer structuré, documenté et concerté.



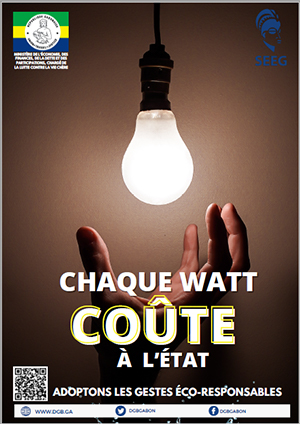














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.