Foi et traditions au Gabon : le choc ou l’alliance ?

À l’heure où les traditions ancestrales cohabitent avec une foi chrétienne largement majoritaire, le clergé gabonais relance le débat sur les tensions et les promesses d’un dialogue entre foi et culture. La 3e édition de la revue TOLEG, présentée le 25 juillet à Libreville, offre une réflexion profonde et courageuse sur ce lien sensible, au croisement de l’identité, de la mémoire postcoloniale et de la spiritualité.

Le Pr Dany Daniel Bekale (micro) lors de sa présentation, le 25 juillet 2025. © GabonReview
Le 25 juillet 2025, la paroisse Saint-Pierre de Libreville a accueilli la présentation du troisième numéro de la revue TOLEG (Théologique et Pastorale du Clergé Gabonais), une publication désormais incontournable dans le paysage intellectuel et ecclésial gabonais. Ce nouveau numéro, publié sous le thème évocateur «Le débat Foi et Culture dans le Gabon Postcolonial : Au-delà des préjugés et des fantasmes», s’impose comme une balise théologique majeure, en phase avec les défis contemporains.
Au cœur de cette présentation, trois conférenciers ont croisé leurs analyses à l’intersection de la foi chrétienne, de l’identité culturelle africaine et de l’héritage postcolonial : le Pr Dany Daniel Bekale, maître de conférences (CAMES) en sociologie de l’éducation à l’Université Omar Bongo, l’abbé Rolin Vianney Mintsa Mi Sima, et l’abbé Sid Eddy Edzang Engouang. La modération de l’événement était assurée par l’abbé Godefroy Abéné Eyé.
Dans une intervention très attendue, le Pr Bekale a proposé une radioscopie sociologique du débat foi et culture en Afrique. Son exposé, articulé autour de trois axes analytiques, a interrogé les interactions entre traditions religieuses locales et christianisme contemporain à travers les notions de syncrétisme, d’acculturation et d’inculturation. Il observe que foi et culture ne s’opposent pas frontalement, mais se rencontrent souvent dans un entrelacs complexe : «Le cas du Gabon postcolonial illustre une configuration où la coexistence entre la culture traditionnelle (rites, danses, croyances animistes) et les exigences doctrinales des Églises donne parfois lieu à des tensions socioreligieuses», a-t-il déclaré.
Dans cette optique, l’universitaire a souligné les dynamiques de recomposition religieuse dans un pays marqué par une triple influence : l’héritage colonial, la tradition locale et les dynamiques mondialistes. Un processus en tension permanente : «Le cas du Gabon montre que la confrontation entre foi et culture ne se résume ni à un rejet mutuel ni à une fusion sans conflit. Il s’agit d’un processus dynamique, traversé par des logiques de résistance, de redéfinition et de négociation symbolique. La sociologie permet d’en révéler les ressorts profonds : entre affirmation identitaire, transformations sociales et quête de sens», a-t-il expliqué.
Réconcilier la foi et les racines

Quelques temps forts de la présentation de l’œuvre. © D.R.
Dans un second temps, l’abbé Rolin Vianney Mintsa Mi Sima a retracé avec passion l’histoire de la revue TOLEG, soulignant sa mission : «Débat, foi et culture en Afrique : Histoire de la Revue TOLEG : Apologétique de l’identité chrétienne pour un Gabon en quête d’espérance».
Ce numéro, selon lui, poursuit un chemin d’engagement prophétique, en appelant à une transfiguration de la société par une foi active dans les sphères politiques, sociales et culturelles. Pour l’abbé Rolin, la foi ne peut être reléguée à la sphère privée ; elle doit nourrir la conscience collective et s’exprimer comme levier d’espérance.
La parole de l’abbé Sid Eddy Edzang Engouang, enfin, a apporté une profondeur théologique à la réflexion. Intitulée : «Débat, foi et culture en Afrique : présentation et intérêt de la question dans ce 3e numéro, Foi et Culture, entre compatibilité profonde et dialogue réconcilié», son intervention a souligné l’urgence de dépasser les clivages hérités de l’histoire coloniale et les malentendus sur l’incompatibilité entre traditions africaines et foi chrétienne. Le titre de la revue «est à la fois évocateur et provocateur, car il nous plonge d’emblée dans un débat vif, souvent polémique, qui touche autant à l’identité profonde de nos peuples qu’au cœur même de notre foi chrétienne. Mais il ne s’agit pas ici d’alimenter des oppositions stériles ou des passions idéologiques. Il s’agit de creuser un sillon de vérité, en dépassant les caricatures, les réductions simplistes et les conflits hérités d’une histoire douloureuse», a-t-il précisé.
Il a également rappelé que ce débat est ancien et fondateur : «En réalité, le dialogue entre foi et culture a germé bien avant les indépendances africaines, au moment même où les premières semences de l’Évangile venaient rencontrer des traditions anciennes, riches, complexes, mais trop vite disqualifiées. C’est ce débat de fond, souvent escamoté ou instrumentalisé, que ce numéro veut reprendre avec rigueur, pédagogie et profondeur théologique».
Jean-Pierre Elelaghe Nze, figure majeure du clergé gabonais
Moment d’émotion, un hommage vibrant a été rendu à l’abbé Jean-Pierre Elelaghe Nze, figure majeure du clergé gabonais. Ce dernier fut l’auteur, en 1977, d’une thèse de doctorat prophétique posant les bases d’un dialogue fécond entre christianisme et traditions culturelles africaines. «Ce volume se distingue par la cohérence de ses contributions et par une progression logique, presque initiatique, dans l’approche du thème pour atteindre comme point culminant l’hommage rendu à l’abbé Jean Pierre Elelaghe Nze dans la recension de sa thèse de doctorat en 1977, thèse prophétique qui posait déjà les jalons d’une rencontre possible, lucide et féconde entre foi et culture», a souligné l’abbé Sid.
Alors que 85 % de la population gabonaise se revendique chrétienne (catholique, protestante ou évangélique), les pratiques traditionnelles (bwiti, rituels fang, cultes ndjobi) continuent de façonner l’imaginaire religieux, parfois dans la clandestinité, souvent en parallèle ou en complément du christianisme. TOLEG se veut un espace de réflexion pour nommer ces tensions et dessiner les contours d’une foi gabonaise, enracinée, libre et ouverte.



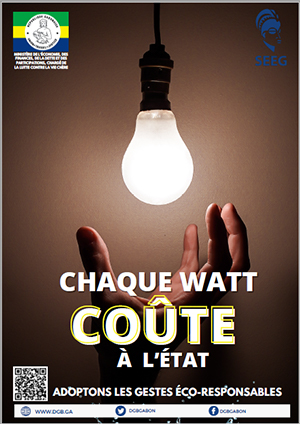














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.