[Tribune] Le PDG face à l’Histoire : Ce qu’il a fait et ce qu’il est appelé à faire

À la veille des législatives et locales de septembre 2025, le Parti démocratique gabonais (PDG) tente de transformer l’épreuve en opportunité. Frappé par la perte du pouvoir en 2023 et secoué par des défections en série, il revendique pourtant une implantation quasi nationale et une longue expérience de l’action publique. Dansl atribune fouillée ci-après, le militant PDG Lévi Martial Midepani invite à relire ce demi-siècle d’histoire pour rappeler que le PDG, loin de se réduire à l’ère Ali Bongo, conserve selon lui les ressorts idéologiques et organisationnels nécessaires pour se réinventer et peser dans le nouvel échiquier politique gabonais.

Maintenant qu’il est seul et une nouvelle fois face à l’histoire, le Parti Démocratique Gabonais est appelé à se réinventer pour servir à nouveau le peuple gabonais. © Gabonreview/Capture d’écran

Militant du PDG, le Dr. Lévi Martial Midépani est docteur en sociologie, Maître-Assistant CAMES, auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale de Paris, diplômé du Civil Service College de Singapour et enseignant de sociologie politique à l’UOB. © GabonReview (capture d’écran
C’est dans un contexte « crisogène », caractérisé par la perte du pouvoir en 2023 et les démissions de plusieurs militants, que le Parti Démocratique Gabonais se présente devant le suffrage du peuple gabonais à l’occasion des élections législatives et locales de septembre 2025. Le scrutin est historique à plus d’un titre. Il est non seulement censé clore définitivement la transition ouverte en aout 2023. Mais il doit surtout permettre au Parti Démocratique Gabonais de trouver sa place dans un paysage politique en pleine recomposition.
Dans cet exercice politique, le parti a certes des faiblesses mais il a aussi des atouts liés à son implantation et à son histoire. Son implantation territoriale lui a permis de présenter 144 candidatures sur les 145 circonscriptions législatives du pays. Soit un taux de couverture de 99%. La même performance est rééditée aux niveaux des conseils municipaux et départementaux où il compétira sur la quasi-totalité des sièges.
L’histoire politique du PDG lui donne l’expérience et les repères indispensables à la formulation d’une offre politique actualisée et utile aux populations gabonaises. Même si ses détracteurs, l’analyse malicieusement au prisme réducteur des quatorze années problématiques de l’ère Ali Bongo, il faut avoir à l’esprit que l’histoire du PDG ne se résume pas à cela mais qu’elle repose sur un ensemble de principes, de discours, de programmes et d’engagements patiemment bâtis depuis plus d’une cinquantaine d’années.
La présente réflexion retrace, sans les épuiser, les apports du Parti Démocratique Gabonais dans la construction nationale. Nous y aborderons tour à tour son obsession pour l’unité nationale (A), ses idéologies et programmes économiques(B), son avant gardisme démocratique (C) et terminerons en esquissant quelques réflexions sur l’avenir de la plus ancienne formation politique gabonaise (D). La somme vise à affirmer que l’être et l’agir pédégiste sont toujours dans l’air du temps.
- Au début était la quête impérieuse de l’unité nationale gabonaise
Les pères fondateurs du parti le concevaient comme « le véritable creuset de l’unité nationale ». Ce principe, énoncé par Albert Bernard Bongo dans le rapport moral et politique qu’il livre lors de l’ouverture du 1er congrès ordinaire du parti en septembre 1970, découlait directement des divisions partisanes qui prévalaient avant la création du PDG.
Dans la conférence qu’il donne lors du premier séminaire regroupant les cadres du parti en septembre 1969, Laurent Biffot, l’un des pionniers de la sociologie politique gabonaise, justifiait la nécessité d’un parti unique par l’inévitable « superposition et identification des partis politiques à des groupes ethniques données » (Rétrospective des partis politiques au Gabon et nécessité d’un parti unique, Premier séminaire du PDG, spécial dialogue, pp 13-24). L’affirmation reposait sur une observation empirique qui attestait que les leaders politiques de cette période faisaient leur marché électoral prioritairement dans leurs bases ethniques. Ainsi il était notoirement connu que l’Union Démocratique et Sociale Gabonaise (UDSG) avait une réelle influence dans la région septentrionale, que le Bloc Démocratique Gabonais (BDG) était surtout implanté dans l’Estuaire et l’Ogooué Maritime et que le Parti de l’Unité gabonaise (PUNGA) recrutait prioritairement ses militants dans les régions méridionales. Les rivalités politiques de cette époque paralysèrent ou du moins retardèrent la construction d’une véritable nation.
Contrairement aux affirmations d’un courant révisionniste de plus en plus visible, les pères fondateurs du PDG n’ont jamais voulu gommer les ethnies du paysage politique gabonais. Ils étaient conscients de l’ancrage ethnique de chaque gabonais. Leur seule ambition était d’extraire de ce magma anthropologique un être national, civique et citoyen s’identifiant avant toute chose à la nation gabonaise.
Sont-ils parvenus à leur objectif ? La question reste ouverte. Ce que l’on constate c’est que par des mécanismes divers et variés (affectations des fonctionnaires hors de leurs régions d’origines, dénomination des provinces à partir de l’hydrologie, systématisation des internats dans les lycées et collèges, urbanisation, encouragement des unions mixtes …) , l’unité gabonaise est aujourd’hui tangible et le désir de faire chemin ensemble toujours vivace.
La construction de l’unité nationale est évidement une œuvre qui concerne tous les gabonais. L’observation minutieuse du temps présent laisse cependant entrevoir quelques faits susceptibles de la remettre en cause. La conscience collective a ainsi été heurtée par les propos d’un ministre de la République déniant le droit à la représentation politique à une catégorie de citoyens au nom de l’autochtonie. Un journal de référence du paysage médiatique gabonais a récemment fait dans la promotion du communautarisme en titrant « Les Ekang prennent date ». Plus grave, un candidat à la présidentielle de 2023, réclamant sa victoire à ce scrutin ne s’est pas interdit de discriminer les officiers généraux de l’armée gabonaise en fonction de leurs origines ethno régionales. Il avait certainement oublié que l’armée est le symbole de l’unité et de l’identité nationale et que sous le drapeau les militaires incarnent la cohésion, le patriotisme et transcendent donc de fait les divisions ethniques, régionales ou religieuses.
Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de dénoncer les manifestations « culturelles » des différentes communautés, il s’agit simplement de susciter une vigie citoyenne face aux manipulations des ingénieurs de l’ethnicité afin de préserver notre vouloir vivre collectif. La mission historique du PDG face à la construction et la préservation de l’unité nationale demeure car comme l’affirmait son président fondateur lors du 1er congrès du parti « C’est au Parti Démocratique Gabonais qui est son cadre et son garant qu’il incombe d’y veiller par tous les moyens, à tous les échelons de la hiérarchie, en s’opposant à toute velléité de division et en combattant partout, où il peut se trouver, l’esprit de tribalisme et de régionalisme »
- Un pragmatisme au service du développement du Gabon
C’est dans le contexte de la guerre froide, marqué par les oppositions idéologiques entre l’Ouest et l’Est, entre le capitalisme et le socialisme que nait le parti en 1968. Adepte des grandes synthèses Albert Bernard Bongo et les compagnons de la Rénovation (Les compagnons de la Rénovation, Témoignages de notre temps, Mémorial du Gabon, 1988) se démarqueront assez rapidement de ses deux systèmes. Le slogan « ni à gauche, ni à droite mais toujours de l’avant » résuma bien le pragmatisme qu’entendait afficher le PDG. En tenant compte des besoins du pays, de son niveau de développement infrastructurel et de ses capacités productives, le compromis entre capitalisme et socialisme donnera naissance à une économie mixte consacrant l’économie de marché tout en instaurant une régulation forte pour en limiter les inégalités. Le parti afficha donc très tôt une orientation social-démocrate à travers des doctrines comme le Libéralisme économique dirigé et planifié ou encore le Progressisme démocratique et concerté. C’est sur la base de ce corpus idéologique et doctrinal que se bâtiront les quinze (15) glorieuses gabonaises, cette période faste qui va de 1970 à 1985 et durant laquelle le Gabon se dota de l’essentiel de ses infrastructures économiques, sociales et culturelles.
Il serait ici fastidieux de dresser un catalogue à la Prévert des réalisations du PDG. Notons simplement qu’à travers les cinq (5) plans quinquennaux qui se succédèrent entre 1967 et 1988, le PDG peut revendiquer un rôle historique dans la construction du Gabon moderne par la mise en place d’infrastructures structurantes (chemin de fer, ports, aéroports, routes, barrages hydroélectriques, électrification des zones rurales …), des services sociaux indispensables au bien-être des populations (écoles, lycées, universités, hôpitaux, protection sociale…)
Il faut toutefois confesser que l’Etat rentier qui avait fini par se constituer était vulnérable aux fluctuations internationales du cours des matières premières. Le double choc externe lié à la baisse vertigineuse des prix du pétrole et à la dépréciation du dollar américain en 1985 allait ainsi lourdement impacter les capacités économiques et sociales de l’Etat. Le recours aux posologies libérales amputera l’Etat de ses leviers économiques à travers un vaste mouvement de privatisations. Les services sociaux tomberont progressivement en déliquescence. Le parti lui-même entrera dans une tourmente qui conduira à la démocratisation des années 1990.
Les soubresauts de cette période seront mis à profit pour abandonner les grandes synthèses économiques et réaffirmer le pragmatisme à travers des programmes concrets de développement. Tel sera l’esprit du nouvel élan (1993), du pacte national de solidarité et de développement (1998) et de mon projet, des Actes pour le Gabon (2005), desquels découlerons des initiatives économiques, sociales et solidaires fortes. Sur la base de ces programmes le Président Omar Bongo exécutera l’une de ses dernières tâches au service du Gabon en posant le 7 avril 2009 la première pierre du complexe industriel de Moanda qui sera inauguré en 2015. L’objectif visé était la transformation locale de nos matières premières. C’est cette vision qui prospère aujourd’hui avec la création des zones économiques dédiées à la transformation du bois et à l’agriculture. Comment ne pas également évoquer la mise en place de la couverture maladie obligatoire par le biais de Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale en 2007. Cette initiative constitue actuellement le pilier de la protection sociale gabonaise. Il faut aussi verser dans ces réalisations la création en 2002 de treize (13) parcs nationaux couvrant 11% du territoire qui ont conféré à notre pays un leadership environnemental mondial incontestable.
- L’avant gardisme démocratique
Trente-cinq (35) ans après, l’histoire du retour au multipartisme dans notre pays n’a certainement pas encore livré tous ses enseignements. L’historiographie a quasiment canonisé les luttes ouvertes ou clandestines des forces politiques et syndicales comme les sources essentielles de cette page de notre histoire commune. Elle tient également pour déterminants les discours et les pressions internationales exercées par les puissances occidentales. Ce faisant elle a souvent minoré, sinon ignoré le rôle des anciens partis uniques dans le retour au multipartisme. Tout au plus les a-t-on qualifiés de freins et d’entraves à la démocratie.
La grille de lecture conditionnaliste n’est pas très pertinente pour le cas gabonais. Si l’on prend pour élément central de cette posture le discours que François Mitterrand prononce à la Baule le 20 juin 1990, il faut tout de suite constater que le processus de démocratisation avait commencé plus tôt au Gabon où la Conférence nationale s’était tenue en mars 1990. C’est donc avec une longueur d’avance sur ses pairs africains que le Président Omar Bongo se présenta à la 16ème conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France.
Cet argument nous permet de relativiser la posture conditionnaliste en considérant le rôle avant gardiste et précurseur que le Parti Démocratique Gabonais a joué dans le retour du pluralisme politique au début des années 1990.
La question démocratique n’avait jamais en réalité été un taboue au sein du Parti Démocratique Gabonais. Même à son apogée comme parti -Etat, le 2ème congrès extraordinaire de 1979 avait opté pour des élections semi compétitives à deux tours. Le premier, sous formes de primaires internes, permettait la sélection des candidats qui se présentaient par la suite au suffrage universel sur une liste bloquée. Sur cette base les élections législatives de 1985 furent très disputées.
Après ces tentatives timides, la question de la démocratisation du régime se posa plus franchement à partir du 3ème congrès ordinaire durant lequel les luttes entre différents courants se feront autour de cette problématique. L’intensité des débats obligea à la convocation d’une session extraordinaire du comité central du parti qui se tint du 11 au 13 janvier 1986 avec un seul point à l’ordre du jour : la démocratisation au sein du parti. Durant ce conclave la question de la démocratie et du multipartisme fut débattue au sein de la commission politique générale. Devant les incompréhensions et les hésitations légitimes, il fut décidé que le retour du multipartisme serait discutée au sein d’une commission ad hoc qui prit le nom de Commission Spéciale pour la démocratie. C’est cette commission qui estima dans son rapport de synthèse du 22 février 1990 que le monolithisme était devenu incompatible avec l’évolution de la société gabonaise. Fort de ce constat, elle proposa que le développement de la démocratie multipartiste soit un objectif à atteindre dans les meilleurs délais « au risque de voir la rue l’imposer ». La Commission Spéciale pour la démocratie du PDG proposa une démarche en deux étapes débutant par une phase préparatoire de trois (3) ans à l’issue de laquelle une convention nationale déciderait des conditions de création des partis politiques.
Ayant pris acte des résolutions de ses camarades, le Président Omar Bongo proposa même la dissolution du PDG et la création du Rassemblement Social Démocrate Gabonais (RSDG), comme cadre laboratoire d’apprentissage de la démocratie. Les inconstances et la versatilité de certains acteurs précipita simplement l’instauration d’um multipartisme qui avait pourtant été courageusement et responsablement anticipé par le Parti Démocratique Gabonais.
Saluant le rôle du parti ayant permis une transition pacifique vers le multipartisme, le Grand Camarade, Président Fondateur dira dans le discours d’ouverture du 5ème congrès extraordinaire de 1991 « Mains blanches, le Parti Démocratique Gabonais a forgé l’unité du pays, mains blanches il a conduit le pays au multipartisme. Serein et confiant, le Parti Démocratique Gabonais œuvrera à la consolidation de la démocratie, en harmonie avec ses idéaux de toujours »
- Jalons d’avenir
Le Parti Démocratique Gabonais a salué l’exemplarité de l’intervention des militaires réunis au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions ( CTRI). Le parti a également appelé les gabonais à se prononcer favorablement pour la nouvelle constitution lors du référendum. De même il a librement choisi de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l’élection présidentielle d’avril 2025.
La position officielle du PDG lui a valu quelques quolibets, notamment de la part d’un ancien cadre du parti qui l’a qualifié « d’aberration politique sans précédent dans l’histoire mondiale » ajoutant « jamais, au grand jamais on n’a vu un parti politique soutenir celui qui l’a renversé du pouvoir. C’est un cas d’école à étudier dans les facultés de sciences politiques ». Ce point de vue passionné est naturellement excessif et les étudiants en sciences politiques savent certainement que, toutes choses étant égales par ailleurs, c’est une attitude souvent observable. Il n’y a ici qu’à citer le cas du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS) renversé en 2023 par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Face à la mobilisation populaire en faveur des militaires et la fermeté du CNSP, la quasi-totalité des cadres du parti fondé par Mahamadou Issoufou a rallié le CNSP. Plus loin au Chili en 1973, après le coup d’Etat contre Salvador Allende, les partis du centre qui le soutenait ont décidés de collaborer avec Pinochet. Les exemples sont légion et l’ancien camarade serait plus inspiré de demander aux étudiants de faire des études comparatives entre ces situations politiques banales et routinières.
Le vrai débat devrait donc porter sur les raisons qui ont conduit le PDG à soutenir toute la transition du référendum jusqu’à l’élection de Brice Clotaire Oligui Nguema. La réponse se trouve évidement dans la préservation des idéaux d’unité, de paix et de stabilité que ce parti a toujours défendu depuis sa création. Par ce choix, le parti fondé par Albert Bernard Bongo et ses compagnons a simplement démontrer que l’intérêt supérieur du Gabon était plus important que la défense mesquine des intérêts partisans.
Dans tous les cas, le PDG entame une nouvelle phase de son histoire. L’onde libératrice qui traverse la société gabonaise depuis l’intervention des militaires l’a doublement impacté. Elle lui a d’abord permis de se défaire de la tutelle des nombreux messagers autoproclamés qui se sont succédés depuis la date symbolique d’octobre 2018. S’érigeant en intermédiaires entre le sommet et la base, ces derniers transmettaient des ordres et des instructions dont on ne pouvait attester de l’authenticité. Elle lui a ensuite permis de se séparer des militants opportunistes qui avaient fini par considérer le parti comme une boite d’intérim dans laquelle ils venaient déposer leur curriculum vitae pour l’obtention d’un emploi ou d’une promotion politique.
Maintenant qu’il est seul et une nouvelle fois face à l’histoire, le Parti Démocratique Gabonais est appelé à se réinventer pour servir à nouveau le peuple gabonais. Ce chantier historique comporte plusieurs axes dont les plus importants sont à notre humble avis, la clarification idéologique, le repositionnement programmatique, le renouvellement générationnel, le renforcement de la discipline et la construction d’alliances. Autant de problématiques qui structurerons certainement le prochain congrès.
Lévi Martial MIDEPANI
Militant du Parti Démocratique Gabonais
.



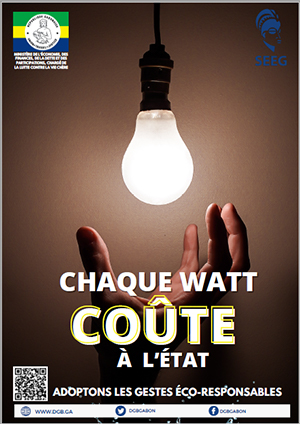














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.