[Tribune libre] Pour une fabrique du modèle social : recadrer une jeunesse en dérive, refonder le citoyen

Alors que le désordre se banalise et que l’imposture devient modèle au Gabon, Benicien Bouschedy pose cette question «à haute voix » : Comment réinventer un lien social brisé ? Face à une jeunesse en perte de repères, l’écrivain originaire de Malinga suggère, dans la tribune ci-après, l’urgence de refonder un imaginaire collectif structurant où l’exemplarité, l’effort et la responsabilité reprennent leur juste place.

© GabonReview
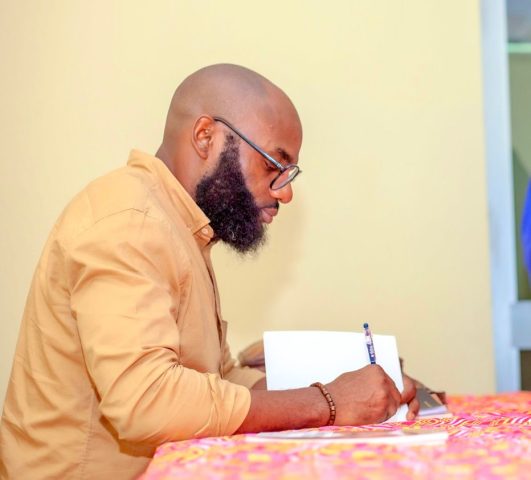
L’écrivain gabonais originaire de Malinga, Benicien Bouschedy. © D.R.
Par ces temps où le désordre est devenu spectacle et la décadence un signe extérieur de réussite, il devient crucial, pour ne pas dire vital, de poser à plat une question que nous éludons depuis trop longtemps : qu’avons-nous fait du lien social ? Celui qui devait unir, transmettre, élever. Voici mon soupçon : ce lien s’est délité, brisé par une succession d’abandons, d’injustices normalisées et de cynismes officiels. Le Gabon ne souffre pas seulement d’un déficit économique ou institutionnel, qui exige les efforts de restauration symbolique, il souffre avant tout d’un effondrement moral. Et le symptôme le plus criant de cette maladie, c’est la dérive normalisée d’une jeunesse enquête d’assistance.
Une jeunesse qui n’aspire plus à apprendre, mais à paraître. Qui ne rêve plus de construire, mais de consommer. Non pas parce qu’elle serait naturellement paresseuse ou violente, comme veut le faire croire une certaine opinion, mais parce qu’on lui a ôté toute colonne vertébrale symbolique. Quand l’espace public érige comme héros des individus sortis du système scolaire, devenus stars de la vulgarité numérique, alors on invite, insidieusement mais efficacement, toute une génération à prendre la délinquance pour modèle et l’imposture pour raccourci. Observez les profils que vos enfants suivent sur les réseaux sociaux et vous verrez qui influence leur imaginaire social. Au nom du fallacieux prétexte du rire, certains rendent viraux des contenus putrides, se targuant le rôle de « partageur », sans mesurer les conséquences psychiques au sein de la communauté jeune.
Ce dérèglement n’est pas fortuit. Il est le fruit d’un projet social inversé, longtemps entretenu par des pouvoirs politiques à courte vue. Pendant plus d’une décennie, les gouvernements successifs ont financé l’indignité, légitimé les passe-droits, valorisé la ruse au détriment du travail. Le spectacle des jeunes fichés pour grand banditisme, roulant en berlines, protégés par des hommes en armes, est devenu banal. Le message était clair : le mérite ne paie pas. Les débats stériles sur la dévaluation des diplômes universitaires et les références académiques par certains disent long sur la déchéance de nos structures sociales. Et l’enfant qui grandit dans un tel environnement ne peut que devenir l’otage de cette vérité tordue.
Alors, que faire ?
Il ne s’agit pas seulement de réprimer ou de moraliser, mais de refonder profondément le socle du vivre-ensemble. Dans Nombril Équatorial (2022), je suggère l’urgence de bâtir ou plutôt de rebâtir une fabrique de modèle social. Car toute société qui aspire à durer doit produire ses propres figures d’élévation : des exemples vivants, accessibles, crédibles. Cela commence par une révolution discrète, mais radicale : celle des valeurs structurantes, portées par les institutions, les médias, l’école, la famille et surtout l’État.
Sur le plan politique, cela suppose que le nouveau septennat, s’il veut marquer l’histoire, doit rompre avec le théâtre de la complaisance et de l’impunité. Le pouvoir ne peut plus être une récompense pour les forts du moment, mais une mission au service du bien commun. Cela passe par une sélection rigoureuse des élites, une véritable séparation des sphères politiques et criminelles et une refondation des outils de contrôle citoyen. La légitimation des « activistes » et d’autres figures veules et immondes dont l’argument public largement partagé et érigé en référence de « lutte » repose sur la délation, le chantage et l’injure facile nécessite un traitement rigoureux.
Sans être sociologue, ma barbe me dit qu’il faut envisager l’éducation comme la colonne vertébrale de la nation. Une éducation non seulement académique, mais aussi civique, morale, culturelle. Il s’agit de réintroduire dans les programmes scolaires les récits fondateurs, les figures historiques positives, les notions de service, de responsabilité, d’effort. Il faut que chaque jeune Gabonais puisse se reconnaître dans une histoire collective et non dans une jungle individualiste. La matière ne fait pas défaut. Des femmes et des hommes de cultures issus de tous ces domaines sont prêts à servir la République dans ce sens. Il suffit de les solliciter afin de l’impliquer dans la fabrique de ces nouvelles utopies communes.
J’ai essayé de calculer l’équation et partage mon résultat : Restauration = Politique nationale de l’exemplarité : encourager les parcours méritants, valoriser le travail discret, honorer les citoyens qui œuvrent au quotidien dans l’ombre. Cela implique un réinvestissement massif dans les institutions culturelles, sportives et communautaires, mais aussi une nouvelle posture de l’État, qui ne doit plus seulement punir après coup, mais prévenir, accompagner, orienter. Le malaise que l’on ressent en réalisant qu’on exige à la jeunesse de produire des résultats sans investissements préalables.
Il nous faut un nouvel imaginaire (je reviendrai là-dessus). L’urgence nous commande d’inventer des narratifs incarnés par des profils dont les parcours suscitent de l’admiration. Notre société ne manque pas de modèle, il nous faut expérimenter cette approche. Car l’âme d’un peuple se forge dans ce qu’il imagine possible. Il est temps de faire rêver autrement : non plus par la frime et la facilité, mais par l’intégrité, la créativité et la solidarité. Faire du citoyen responsable la nouvelle figure du prestige. Une jeunesse recadrée n’est pas une jeunesse enfermée, c’est une jeunesse éclairée. Et une nation qui éclaire sa jeunesse construit sa liberté. Le reste n’est que sursis.



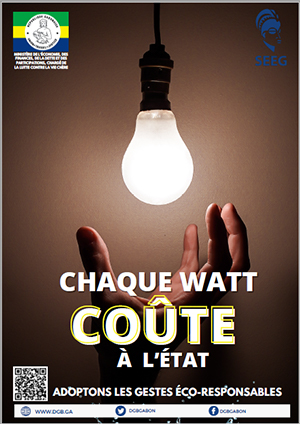














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.