À l’entame de la campagne pour les législatives : Un enjeu symbolique

Les élections du 27 septembre prochain ne visent ni à changer de politique ni à changer de gouvernement, mais à témoigner du fonctionnement de la démocratie. On ne doit pas demander aux candidats d’afficher des programmes, mais de parler de leur engagement civique et citoyen.

Si les parlementaires peuvent toujours porter des idées, c’est davantage pour influencer l’opinion en espérant peser indirectement sur la marche des choses. En aucun cas, ils ne peuvent pousser à un changement de politique, le gouvernement n’étant plus responsable devant eux. © GabonReview
Promulguée le 19 décembre 2024, la Constitution consacre un régime politique inconnu des constitutionnalistes. Du coup, dans la perspective des législatives à venir, notre pays se trouve condamné à une campagne inédite. Là où on devrait s’attendre à une comparaison des programmes, il faudra accepter une confrontation de personnalités. Et pour cause : peu importe les résultats, l’offre politique approuvée le 12 avril dernier sera mise en œuvre. Contrairement à la pratique jusque-là en vigueur, la composition du futur gouvernement ne sera pas fonction de la coloration du Parlement, mais de la perception et de la conviction du président de la République. Trop souvent occultée, cette double vérité risque de transformer le jeu politique en une foire d’empoigne, où les combinaisons d’arrière-cour et autres attaques ad hominem rythment les journées.
Comment les institutions interagiront désormais ?
Comme nous le relevions durant la campagne référendaire, la Constitution induit de profonds changements. Dans la répartition des compétences, comme dans les relations interinstitutionnelles, elle appelle une nouvelle approche. Pour ce faire, il convient de relire le texte et de l’analyser sans arrière-pensée, mais avec froideur et lucidité. Au-delà des accointances, opinions et affiliations partisanes, chacun gagnerait à se pencher sur les préconisations relatives à l’organisation du pouvoir exécutif et aux rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Sans se laisser intimider par les affirmations péremptoires, chacun doit chercher à comprendre comment les institutions interagiront désormais. N’en déplaise aux adeptes des théories brumeuses, le renforcement des pouvoirs du président de la République a eu un impact sur le positionnement du Parlement. Dès lors, les postulants à la fonction de parlementaire ne peuvent ne pas en tenir compte.
Depuis l’entrée en fonction de Brice Clotaire Oligui Nguema en qualité de chef de l’Etat et chef du gouvernement, notre pays est passé de la dyarchie exécutive à un exécutif moniste. Désormais, le président de la République peut gouverner sans majorité parlementaire. Si les parlementaires peuvent toujours porter des idées, c’est davantage pour influencer l’opinion en espérant peser indirectement sur la marche des choses. En aucun cas, ils ne peuvent pousser à un changement de politique, le gouvernement n’étant plus responsable devant eux. Or, dans le même temps, le président de la République dispose du pouvoir de dissolution : à la collaboration ou à la dépendance réciproque s’est substituée la subordination. Quel enjeu pour ces législatives ? Il est essentiellement symbolique et quelque peu politique : pour les partis, il s’agit d’affirmer leur existence et de se doter d’une tribune institutionnelle ; pour les candidats, il s’agit de se construire une légitimité et se doter d’un statut social respectable.
Nouveau contexte juridico-institutionnel
Comment battre campagne dans un tel contexte ? En misant davantage sur l’image, en se posant en courroie de transmission entre le petit peuple et les élites dirigeantes, en valorisant le vécu personnel et en misant sur les réseaux. Pour cette raison, la bataille de positionnement entre l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) et le Parti démocratique gabonais (PDG) tombe sous le sens, chacune des deux formations s’efforçant de se rattacher au président de la République. De même, on comprend pourquoi les alliances se nouent non pas en fonction de stratégies nationales, mais au gré d’intérêts individuels. Au-delà, on comprend aussi pourquoi de nombreux slogans parodient ou rappellent ceux utilisés par Brice Clotaire Oligui Nguema. Après tout, les partis, associations et personnalités ayant naguère constitué le Rassemblement des bâtisseurs (RdB) peuvent légitimement s’en réclamer ou se dire «bâtisseurs».
Dans le nouveau contexte juridico-institutionnel, les élections du 27 septembre prochain ne visent ni à changer de politique ni à changer de gouvernement, mais à témoigner du fonctionnement de la démocratie, en dépit d’un «présidentialisme renforcé à la gabonaise». À moins de se complaire dans des analyses erronées ou de se satisfaire de déductions fallacieuses, on ne doit pas demander aux candidats d’afficher des programmes ou de faire valoir des idées. En revanche, on doit leur exiger de décliner leurs états de service, de parler de leur engagement civique et citoyen. Sont-ils acquis à l’Etat de droit ? Qu’ont-ils déjà fait pour garantir la transparence dans la vie publique, élargir l’espace civique ou en finir avec les privilèges, l’arbitraire et l’impunité ? Sans se lasser, il faudra leurs poser ces questions déterminantes pour la consolidation de la démocratie et l’enracinement d’une «culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable».



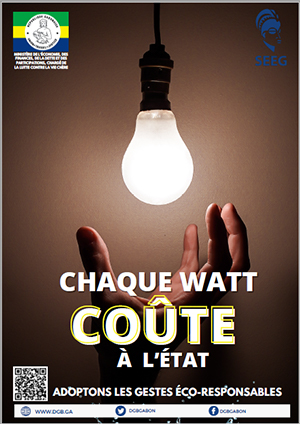














0 commentaire
Soyez le premier à commenter.