L’accord de Paris est mort, on fait quoi ?

L’Accord de Paris est mort. Loin des promesses initiales et des ambitions affichées en 2015, il n’a pas résisté à la réalité implacable du climat et aux contradictions des politiques énergétiques mondiales. Adrien NKoghe-Mba* dresse ici un constat sans appel : le seuil des 2°C de réchauffement sera dépassé, les financements promis aux pays du Sud ne viendront pas, et les grandes puissances ne sauveront personne. Face à cette impasse, une seule voie demeure : celle de l’autonomie, de la résilience et d’une coopération renforcée entre les nations du Sud.
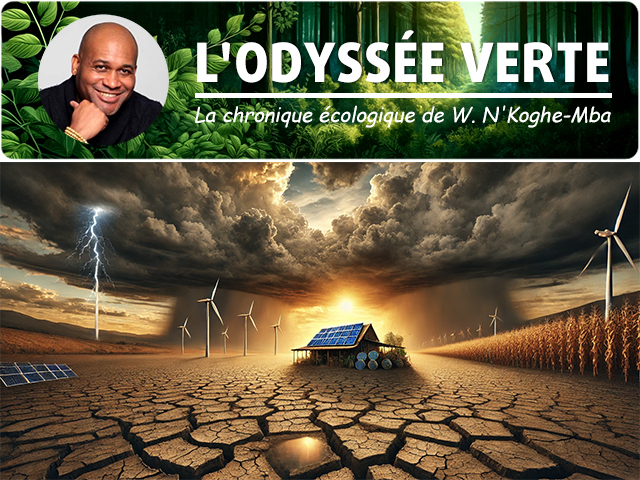
L’accord de Paris est mort. Les promesses n’ont pas suffi, les politiques ont échoué, et la réalité climatique nous dépasse. «Ce sont nos terres, nos cultures, nos villes qui seront affectées». © GabonReview
L’accord de Paris est mort. Les promesses n’ont pas suffi, les politiques ont échoué, et la réalité climatique nous dépasse. L’objectif de limiter le réchauffement planétaire à 2°C d’ici 2100, par rapport aux niveaux préindustriels (avant 1850), est désormais inatteignable. Des décennies d’émissions excessives, combinées à une dépendance mondiale aux combustibles fossiles, ont rendu ce seuil hors de portée. Même avec des efforts drastiques, les climatologues estiment que nous dépasserons cette limite bien avant la fin du siècle. Avec ce seuil désormais derrière nous, les illusions d’un équilibre fragile entre développement et préservation de la planète s’effondrent. Mais pour les pays du Sud, la question n’a jamais été simplement de réduire des chiffres sur du papier. C’est une question de survie.
Mais d’abord, c’était quoi l’accord de Paris ? Signé en 2015 par 196 pays, il visait à limiter le réchauffement de la planète à un niveau inférieur à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, idéalement 1,5°C. Il reposait sur des engagements volontaires des pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en promettant des financements des nations riches pour aider les pays les plus vulnérables à s’adapter. En théorie, c’était un tournant historique. En pratique, ce n’était qu’un début, et ce début n’a pas abouti.
Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ce n’est plus physiquement possible. La consommation énergétique mondiale, encore largement basée sur le charbon, le pétrole et le gaz, continue d’augmenter, surtout dans des pays en plein développement. Les climatologues, comme James Hansen, ancien de la NASA, l’ont dit clairement : même si nous réduisons immédiatement nos émissions, les phénomènes climatiques sont déjà trop avancés. Nous avons franchi certains points de non-retour. Les courants océaniques ralentissent, les glaces fondent à une vitesse record, et les températures ne cesseront de grimper au-delà de 1,5°C, puis de 2°C.
En Argentine, Javier Milei envisage de quitter l’accord de Paris. En Indonésie, on se demande pourquoi continuer à suivre un cadre que même les États-Unis ont délaissé. Pendant ce temps, les pays du Sud, ceux qui devraient être les premiers à recevoir l’aide promise, se préparent à affronter des vagues de chaleur extrême, des inondations dévastatrices et des sécheresses chroniques. Une étude récente montre qu’avec un réchauffement de +2°C, la surface terrestre exposée à des températures insoutenables sera multipliée par trois. Ce sont nos terres, nos cultures, nos villes qui seront affectées.
Et nous savons aussi que la solution ne viendra pas des promesses de financement du Nord. La suppression de l’USAID par l’administration Trump, ajoutée à la pression sur les Européens pour augmenter leur budget militaire via l’OTAN, montre clairement que la solidarité internationale n’est plus une priorité. Les 300 milliards promis lors de la COP29 de Bakou ? Un mirage. Compter sur l’aide extérieure est devenu une illusion dangereuse.
Alors, on fait quoi ?
D’abord, nous arrêtons d’attendre que les grandes puissances nous sauvent. Le futur des pays du Sud se construira par nous-mêmes. Il est temps de renforcer les initiatives locales et régionales. Que ce soit par des projets d’énergies renouvelables adaptées, des systèmes agricoles résilients face à la sécheresse ou des programmes de protection des zones côtières, notre survie passera par des solutions enracinées dans nos réalités.
Ensuite, il faut revoir notre modèle de développement. La croissance à tout prix, portée par des énergies polluantes, n’est plus une option. Nous avons l’opportunité de bâtir un futur plus durable en investissant dans des infrastructures propres et des économies circulaires, tout en intégrant les savoirs traditionnels et les innovations modernes.
Enfin, la coopération Sud-Sud doit devenir la colonne vertébrale de notre réponse au changement climatique. Nos luttes sont similaires, nos enjeux sont liés. Ce n’est qu’en partageant les ressources, les connaissances et les technologies que nous pourrons maximiser notre résilience commune. La dépendance envers les grandes puissances doit céder la place à une solidarité entre nos propres nations.
L’accord de Paris est peut-être mort, mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Pour les pays du Sud, c’est une chance de prendre le contrôle de notre avenir, de ne plus être les victimes silencieuses d’un système défaillant. Nous n’avons plus le luxe d’attendre, et c’est peut-être là notre plus grand atout : agir maintenant, selon nos propres termes.
*Directeur général de l’Institut Léon Mba et président de l’association Les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo.

















0 commentaire
Soyez le premier à commenter.