Procès Esther Miracle : le 7 août, pour que les morts parlent et que l’État réponde

Plus de deux ans après le naufrage de l’Esther Miracle, l’une des plus grandes tragédies maritimes du Gabon moderne, le procès engagé en juin 2025 vient de franchir un seuil critique. Le 26 juillet, le tribunal correctionnel de Libreville s’est penché sur deux questions capitales : la légalité de la détention prolongée de plusieurs inculpés clés et la possible comparution de l’État gabonais comme partie civilement responsable. Une double décision est attendue pour le 7 août, porteuse d’implications lourdes pour la suite du procès et la crédibilité de l’État. Analyse sommaire.

Le procès de l’Esther Miracle deviendra soit une banale gestion d’un drame, soit une véritable catharsis nationale. © GabonReview
Alors que les débats sur le fond n’ont pas encore livré leurs vérités ultimes, les enjeux de procédure prennent, à ce stade, des allures de révélateurs politiques et institutionnels. Le procès de l’Esther Miracle, loin de se réduire à la mécanique judiciaire des responsabilités pénales, interroge les limites de l’État de droit, la permanence de la justice dans les affaires sensibles, et la capacité d’un gouvernement à assumer sa part d’ombre. Le 7 août prochain, la justice gabonaise aura l’occasion de se confronter à elle-même.
Une détention flirtant avec l’illégalité
Incarcérés depuis avril 2023, soit plus de 18 mois à ce jour, plusieurs inculpés – au premier rang desquels l’ex-directeur général de la Marine marchande Fidèle Angoue Mba et le propriétaire de la compagnie Royal Cost, Armand-Blaise Mbadinga – voient leur maintien en détention devenir un nœud juridique. La défense a martelé, Code de procédure pénale en main, que l’article 134 interdit expressément une détention préventive excédant 18 mois en matière correctionnelle. En clair : leurs clients doivent être libérés d’office.
L’argument n’est pas mince. Il ne s’agit plus ici de plaider une faveur, mais d’exiger le respect de la norme. Dans un État de droit, la règle prévaut, fût-elle inconfortable. En maintenant ces prévenus derrière les barreaux, la justice ne risque-t-elle pas de fausser sa propre légitimité ? Pourtant, en face, la partie civile redoute qu’un relâchement précipité vide le procès de sa consistance, et ouvre la voie à des manœuvres d’évitement ou d’intimidation. L’équilibre est fragile : garantir les droits des inculpés sans trahir les attentes des familles endeuillées.
L’État convoqué sur son propre banc des accusés
Autre point de cristallisation : la volonté exprimée par les avocats des parties civiles de faire comparaître l’État gabonais en tant que partie civilement responsable. Plus précisément, ils demandent que deux anciens hauts responsables – Alain-Claude Bilie-By-Nze, alors Premier ministre, et Brice-Constant Paillat, ex-ministre des Transports – soient entendus. L’enjeu est clair : établir si des dysfonctionnements institutionnels, notamment dans la chaîne des secours, ont aggravé la tragédie du 9 mars 2023.
Ce n’est pas seulement un appel à la transparence : c’est une tentative d’ouvrir le procès à sa dimension systémique. Car derrière les négligences alléguées, c’est toute une culture administrative, une chaîne de commandement, et une inertie politique qui pourraient être mises en accusation. L’État peut-il encore se retrancher derrière l’écran de l’irresponsabilité alors qu’il proclame, par ailleurs, vouloir moraliser la vie publique ?
Le 7 août, un moment de vérité pour la justice gabonaise
La décision que rendra le tribunal le 7 août 2025 ne portera pas seulement sur deux requêtes procédurales : elle dira quelque chose de plus profond sur l’état de la justice dans le pays. En choisissant de faire droit, ou non, aux demandes de libération provisoire, en acceptant – ou non – de faire comparaître l’État, les juges poseront un acte à la fois juridique et symbolique. Le procès de l’Esther Miracle deviendra alors soit une banale gestion d’un drame, soit une véritable catharsis nationale.
Au-delà du droit, c’est la confiance collective qui est en jeu. L’engagement du président de la post-transition, le général Brice Oligui Nguema, de «rendre justice aux familles», ne pourra tenir que si les institutions judiciaires osent s’élever au-dessus des pressions et des calculs. Le 7 août pourrait bien marquer la différence entre un procès mémoriel et un procès historique.



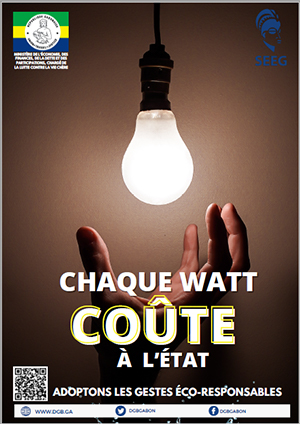














1 Commentaire
Bjr. Morceau au choix1 : « 1-L’équilibre est fragile : garantir les droits des inculpés sans trahir les attentes des familles endeuillées ».
Morceau au choix 2-une culture administrative, une chaîne de commandement, et une inertie politique qui pourraient être mises en accusation.
Morceau au choix 3-ne pourra tenir que si les institutions judiciaires osent s’élever au-dessus des pressions et des calculs.
N.B: Les mots clés: trahir, inertie politique, les institutions judiciaires osent s’élever. Ces mots sont révélateurs d’un mal être judicaire qui confinent le citoyen gabonais dans le doute et le rejet de sa justice.
Nous attendons tous que le contraire nous soit démontré. Amen.