[Tribune Libre] Militantisme et républicanisme : La restauration des institutions à l’épreuve de la critique

Dans le cadre de la «réflexion collective et spontanée» menée par quelques jeunes Gabonais (enseignants-chercheurs et observateurs de la situation sociopolitique du pays) sous le thème «Quelle transition pour quelle restauration ?», Antoine Borugh Bu Djorh, enseignant-chercheur en Philosophie politique et morale, aborde quant à lui le thème «Militantisme et républicanisme : La restauration des institutions à l’épreuve de la critique». «En ces temps de mutations institutionnelles, il paraît urgent de (re)penser, à nouveaux frais, la relation entre le militantisme politique et le républicanisme qui, dans l’ancien régime, a paralysé le fonctionnement des institutions républicaines», estime-t-il dans la Tribune libre ci-après.

«Il paraît urgent de (re)penser, à nouveaux frais, la relation entre le militantisme politique et le républicanisme…». © D.R.

Le Dr Antoine Borugh Bu Djorh, Enseignant-chercheur en Philosophie politique et morale. © D.R.
Le coup d’État du 30 août 2023 marque sans doute un nouveau tournant dans l’histoire du Gabon. Il a en effet suscité un réel enthousiasme et une euphorie chez plusieurs Gabonais, car cela s’inscrivait dans la même direction que le vent du changement tant espéré depuis bien longtemps. Pour autant, au-delà de cette liesse populaire, il est nécessaire que l’émotion s’éclipse un tant soit peu pour céder la place à la raison, d’autant plus que les enjeux sont énormes et les défis colossaux. En ces temps de mutations institutionnelles, il paraît urgent de (re)penser, à nouveaux frais, la relation entre le militantisme politique et le républicanisme qui, dans l’ancien régime, a paralysé le fonctionnement des institutions républicaines.
En effet, la défense des intérêts partisans a souvent été placée au-dessus de l’intérêt supérieur de la nation. Au lieu de servir la République, c’est le président du parti au pouvoir qui a tout ce temps été servi. Il se trouve que ce dernier était aussi le président de la République. Cette situation complexe, qui a très souvent été observée sous le règne du «régime Bongo-PDG», a permis d’avoir à la tête des institutions et des administrations, des personnalités qui n’avaient pour seul souci que la défense de leurs intérêts. Parfois, l’ascension sociale et les privilèges de ces personnalités résultaient en partie de leur militantisme politique et moins de leurs compétences, de leur intégrité ou de leur expérience.
Ainsi, en prenant le pouvoir, la junte militaire a fait de la question institutionnelle sa principale priorité. C’est dire à quel point la question des institutions est à la fois cruciale et existentielle pour le devenir de notre État. Eu égard à ce qui précède, comment défendre les intérêts de sa formation politique sans pour autant paralyser les institutions de la République ? Pour ce faire, dans un premier moment qui se veut d’abord descriptif, nous examinons ce qui jusque-là a toujours constitué des blocages. Quant au second, il s’inscrira dans une approche normative parce qu’il entend ouvrir des perspectives à ce qu’il conviendra désormais d’adopter comme attitude républicaine pour parvenir à une société plus juste et plus démocratique.
L’expérience du militantisme au tribunal de la raison
Au Gabon, il est frappant de constater que les nominations de l’élite politico-administrative gabonaise obéissent souvent à un schéma militantiste plutôt qu’à une logique républicaine. Ces nominations, qui devaient pourtant répondre aux critères de compétences, d’intégrité et de probité, visaient plutôt à récompenser le militantisme politique des uns et l’appartenance aux réseaux clanique et maçonnique des autres. Cette réalité présentait sans doute un enjeu au niveau de la conservation du pouvoir d’autant que, pour imposer son hégémonie, Omar Bongo nomma à des postes stratégiques des fidèles parmi les fidèles, avec lesquels il partageait des liens familiaux, claniques, maçonniques et politiques. C’est pourquoi, même à l’échelle la plus réduite de l’appareil étatique, ceux qu’on y retrouvait étaient en grande majorité issus des rangs du PDG.
Si cela visait vraiment à changer les choses, on n’en serait pas à ce stade, mais c’est un constat d’échec qui apparaît, dans la mesure où certains sont devenus aveugles à la souffrance de nombreux Gabonais qui, dans les quartiers et les villages, ont parfois du mal à joindre les deux bouts. Alors que le chômage asphyxie les couches sociales défavorisées, que les hôpitaux peinent à assurer des soins de santé dignes de ce nom, et qu’on a des effectifs pléthoriques dans les écoles à cause de l’insuffisance des structures d’accueil, certains se «remplissent les poches» sans le moindre scrupule. D’autres se sont érigés en véritables «roitelets», faisant et défaisant les carrières de nombreux jeunes au seul motif que ces derniers sont d’une autre sensibilité politique.
Or, tout cela semblait obéir à une logique, celle que Jean-François Bayart appelle la «politique du ventre» (L’État en Afrique : la politique du ventre,1989). Dans une perspective sociologique, Bayart décrit les logiques politiques de gestion du pouvoir, en mettant en lumière un mode d’exercice particulier du pouvoir qui consiste à satisfaire les intérêts de sa famille biologique, clanique et politique au détriment de l’intérêt de la nation. Or, derrière son approche descriptive, il y a une volonté de dénoncer l’incapacité des élites africaines à faire preuve de grandeur, c’est-à-dire à dépasser les intérêts égoïstes au nom de l’intérêt supérieur de la nation.
Dans le cas du Gabon en particulier, cette situation a constitué un véritable blocage voire une paralysie des institutions dans la mesure où certains militants, pour s’imposer politiquement, ont été parfois amenés à faire des choix qui visaient beaucoup plus à satisfaire (le) ou à plaire au président du parti pour bénéficier en retour des avantages tels que des promotions, des biens matériels ou des honneurs. Preuve que le militantisme politique a conduit certains à penser d’abord à leurs intérêts personnels tout en oubliant la question du développement socio-économique et celle de l’intégrité de nos institutions.
En outre, l’arrivée au pouvoir d’Ali Bongo n’a vraiment rien changé à cette réalité, même si on a assisté à l’ascension d’une certaine élite politique, qui s’est aussi soldée par l’éviction de ceux qu’on appelle «les caciques», c’est-à-dire ceux qui ont servi l’ancien Président, Omar Bongo. À cet effet, un des proches d’Ali Bongo avait très bien résumé la situation en ces termes : «On ne fait pas du neuf avec du vieux». Et plus récemment encore, un autre soutenait : «Celui qui boude, il bouge». Au fond, de tels propos témoignent tout simplement d’un manque de sagesse et sont symptomatiques d’une vision politique étriquée et cupide. Par conséquent, l’expérience «militantiste», telle qu’elle a été vécue jusqu’à ce jour, a été très peu bénéfique au fonctionnement des institutions. Ce n’est pas du tout le fruit du hasard si les autorités de transition en font une priorité. Il faut alors en tirer les conséquences, et envisager des nouvelles mesures afin de restaurer nos institutions et par extension nos administrations publiques. Faut-il, pour cela, mettre un terme au militantisme politique ? Car, au lendemain du putsch du 30 août 2023, le chef de la junte affirmait en substance «qu’il n’y a plus d’opposition ni de majorité».
À ses yeux, seul l’intérêt de la nation prévaudra au détriment des querelles partisanes et des intérêts égoïstes. Une telle approche n’est-elle pas aux antipodes de la vision de la démocratie ? Peut-on vraiment envisager la restauration des institutions sans l’activité des partis politiques ? Comment alors restaurer les institutions dans un contexte fortement marqué par l’ancrage du militantisme politique dans la vie des citoyens gabonais ?
De la primauté de la République sur l’idéologie des formations politiques
Restaurer les institutions politiques n’est pas une tâche aisée. Bien au contraire, il s’agit de la chose la plus complexe dans l’histoire d’une République, car une telle entreprise exige qu’on s’attaque aussi bien à la structure qu’à ce qui relève du fondement d’un État. Mais que signifie restaurer ? Qu’est-ce qui sous-tend la restauration d’une institution républicaine ? Suffit-il de changer un homme (à la tête d’une institution) par un autre pour parler de restauration ? En d’autres termes, quelles sont les conditions de possibilités d’une restauration des institutions républicaines ? Restaurer une institution renferme une double acception : soit on remonte le temps pour rétablir les institutions dans leurs états anciens ou dans leurs formes premières, ce qui paraît tout de même difficile, car dans l’histoire du Gabon, a-t-on vraiment eu un modèle d’institutions qui vaille la peine d’être exhumé ? Soit on s’inscrit dans une logique réparatrice, qui consisterait non pas à remplacer un régime par un autre ou simplement à changer une personne par une autre, mais il s’agit véritablement de changer les mentalités, c’est-à-dire qu’il faut un changement dans le mode de pensée de la classe dirigeante.
Ainsi, les autorités de transition ne devraient surtout pas tenter d’exhumer un certain passé : ce serait un échec. Il faut envisager un véritable changement de paradigme, c’est-à-dire une rupture au sens où l’entend Thomas Kuhn (La structure des révolutions scientifiques). Il ne peut être question d’évolution, mais de révolution avec l’ordre ancien. Lors de sa visite au Ghana en 2009, le président Barack Obama a prononcé un discours dans lequel il affirmait : «L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions». Aux yeux de l’élite africaine, ce propos est apparu comme une volonté de l’ancien président américain de s’ériger en donneur de leçon ; une attitude paternaliste qui est souvent reprochée aux Occidentaux.
Il reste qu’une lecture lucide et critique permet de constater que l’une des racines du mal de l’Afrique résiderait dans le fait d’avoir des hommes forts à la tête des institutions. Tout le problème est donc de savoir qui seraient ces «hommes forts». Seraient-ce des militaires comme c’est le cas au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, ou plus récemment au Gabon depuis le 30 août 2023 ? Ou au contraire, sont-ce des acteurs politiques issus des rangs de la société civile ? Et que faut-il entendre par l’expression «fortes institutions» ? Et comment penser des fortes institutions sans hommes forts ? La force des institutions n’est-elle pas tributaire de celle des hommes et femmes qui les incarnent ? Ou sont-ce les fortes institutions qui génèrent des hommes forts ?
Les «hommes forts» peuvent souvent renvoyer à ceux à qui on a confié une parcelle de pouvoir et qui, au lieu d’être au service du peuple, se servent de celui-ci pour assurer leurs propres intérêts. Il peut s’agir aussi bien des militaires que des acteurs politiques. Il s’agit aussi de ceux qui confondent «autoritarisme» et «autorité» ; ceux qui sont dans une dérive autoritaire du pouvoir. Mais «les hommes forts» désignent surtout ceux qui savent faire preuve de courage, qui refusent de s’enfermer dans les idéaux des partis politiques, ceux qui savent placer les valeurs républicaines au-dessus des valeurs «militantistes» ou claniques. Ce sont ces hommes que Nietzsche appelle à juste titre «les esprits libres» (Humain, trop humain).
Il s’agit de ceux qui ont le pouvoir de se libérer de toutes les chaînes sociales, politiques et religieuses que le sens commun accepte impuissamment. Ils sont capables de sortir des sentiers battus et d’affirmer leur singularité. Dit autrement, il peut s’agir des hommes d’État, ceux qui servent les citoyens, l’État et la nation, et font passer le bien commun avant leurs intérêts personnels ou leurs carrières politiques. À titre d’exemple, l’ancien président sud-africain, Nelson Mandela (1994-1999), fait sans doute partie de ces hommes. Dans le cas du Gabon d’après transition, a-t-on besoin d’hommes forts ou de fortes institutions ? Si l’on s’en tient au contexte gabonais où, depuis l’avènement du pluralisme démocratique, les institutions n’ont été qu’au service d’un seul homme (Omar Bongo et après lui son fils Ali Bongo), il est clair que le Gabon a davantage besoin de fortes institutions.
Il faut en effet que les citoyens servent les institutions et non un homme. Pour ce faire, l’on devrait mettre de côté le culte de la personnalité, mener de réelles enquêtes de moralité et procéder dans certains cas à des auditions. Ainsi, les hommes forts qui animeront ces institutions devraient être guidés par deux principes : l’intégrité et l’impartialité. Or, cela n’est possible que si l’on évite de nommer à la tête des institutions des hommes et femmes qui servent soit les intérêts d’un parti, soit les intérêts d’une famille au détriment de l’intérêt supérieur de la nation. Par conséquent, défendre l’intérêt supérieur de la République mettrait ainsi les institutions à l’abri des conflits d’intérêts comme ce fut le cas avec l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle. Il était connu de tous qu’elle fut la maîtresse de l’ancien Président Omar Bongo, et donc belle-mère du Président déchu, Ali Bongo. Comment l’institution qu’elle a présidée pouvait-elle devenir autre chose que «la tour de Pise» ? Par ailleurs, nommer à la tête de l’organe chargé de l’organisation des élections un militant d’une formation politique n’est-il pas de nature à discréditer les institutions ?
En somme, restaurer des institutions apparaît dès lors comme une entreprise de longue haleine. Certes, il est indispensable, pour la vie démocratique, de militer pour tels ou tels partis politiques, mais il est encore plus crucial de savoir jusqu’où on peut aller dans notre militantisme. Pour que les institutions soient démocratiques, justes et crédibles, le processus de nomination de ses membres devrait, au-delà des compétences et/ou de l’expérience, reposer sur deux principes : le principe d’intégrité et le principe d’impartialité. Ainsi, la bonne santé d’une démocratie ne doit guère se faire au détriment du bien commun.
Par le Dr Antoine Borugh Bu Djorh, Enseignant-chercheur en Philosophie politique et morale. Membre du Centre Universitaire de Recherches sur l’Action publique et le politique (UMR 7319 CURAPP- ESS, CNRS-UPJV/ France).


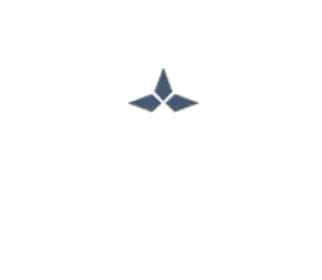








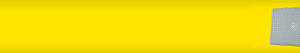

0 commentaire
Soyez le premier à commenter.